Présentation du texte Dilexi Te
Résumé structuré de Dilexi Te (Exhortation apostolique de Léon XIV sur l’amour envers les pauvres), avec les points essentiels et quelques citations clés.
1. Contexte et introduction
- Dilexi Te est une exhortation apostolique publiée le 4 octobre 2025 par le pape Léon XIV. Vatican
- Elle s’inscrit en continuité avec l’encyclique Dilexit nos du Pape François, et reprend un appel permanent de l’Église à être proche des pauvres. Vatican
- Dans l’introduction, le Pape rappelle la parole d’Apocalypse 3.9 : « Je t’ai aimé », adressée à une communauté faible et méprisée, pour souligner que même ceux sans puissance ont été aimés par Dieu. Vatican
2. Diagnostic de la pauvreté et appel à l’Église
- Le texte définit la pauvreté comme un cri dans l’histoire : non seulement individuelle mais aussi collective, renvoyant aux structures politiques, économiques, sociales. Vatican
- On y lit que la pauvreté « n’est pas d’aucune fatalité mais de structures injustes ». Vatican
- Le Pape distingue plusieurs formes de pauvreté : matérielle, sociale (marginalisation), morale / spirituelle, culturelle. Vatican
- Il invite à un changement de mentalité : les mentalités collectives, les systèmes culturels, les priorités sociales doivent être repensés. Vatican
3. Fondements bibliques et théologiques
- Dilexi Te s’appuie sur de nombreux textes bibliques pour montrer que Dieu « choisit les pauvres », qu’Il entend leur cri, et qu’il y a une forte tradition chrétienne ancienne en faveur des nécessiteux. Vatican
- Il rappelle que Jésus « s’est fait pauvre » (cf. Phil 2,7 / 2 Co 8,9) pour identifier sa mission à la faiblesse humaine. Vatican
- Le texte cite des Pères de l’Église (par ex. Augustin, Jean Chrysostome, la tradition monastique ou mendiantes) pour montrer que la charité concrète envers les pauvres est partie intégrante de la vie chrétienne depuis les débuts. Vatican
- Il affirme que la charité n’est pas optionnelle mais constitue un critère du vrai culte. Vatican
4. Vision de l’Église : « Église pauvre pour les pauvres »
- Le texte propose que l’Église ne soit pas seulement une institution qui aide les pauvres « depuis l’extérieur », mais qu’elle soit configurée dans sa structure, sa mission, sa vie comme « pauvre pour les pauvres ». Vatican
- On lit que cette attention aux pauvres doit être insérée dans la mission ecclésiale, dans le culte, dans la vie communautaire, et qu’il y a un lien inséparable entre la foi chrétienne et le souci pour les démunis. Vatican
- Le Pape mentionne que cela doit se vivre non seulement par des œuvres de miséricorde mais aussi par des gestes de diaconie, par des ministères (anciens et actuels), par des choix structurants au sein de l’Église. Vatican
5. Appels concrets et engagement
- Le texte appelle non seulement à la compassion individuelle, mais à l’engagement concret : accueil, partage, service des malades, des exclus, des captifs. Vatican
- Il mentionne la responsabilité collective et institutionnelle : l’Église, ses ministères (diaconie, hospitalité, ordres religieux, œuvres sociales traditionnelles) sont concernés. Vatican
- Il rappelle que l’engagement envers les pauvres ne doit pas remplacer la revendication de justice : « l’aumône ne dégage pas les autorités compétentes de leurs responsabilités, ni ne remplace la lutte légitime pour la justice. » Vatican
- Le Pape invite les croyants à participer à la transformation sociale « par votre travail, votre lutte pour changer les structures… ou encore par ce geste d’aide simple, très personnel et proche ». Vatican
6. Conclusion et ton final
Le texte appelle chacun à se demander : est-ce que mon amour / ma vie de foi touche aujourd’hui les plus pauvres de façon visible, concrète, non seulement par un geste ponctuel, mais comme mode de vie chrétienne ?
Dilexi Te s’achève sur une invitation forte à ce que l’amour chrétien soit « prophétique » et sans limites : « L’amour chrétien brise toutes les barrières, rapproche ceux qui sont éloignés… rend familiers les étrangers… franchit des abîmes humainement insurmontables… » Vatican
Analyse nuancée de l’exhortation apostolique Dilexi Te (Léon XIV, 2025)
replacée dans une perspective réformée classique, à la lumière de Jean Calvin et d’Abraham Kuyper
1. Un texte profondément chrétien dans son intention
Le pape Léon XIV, en affirmant que « la charité n’est pas une voie facultative, mais le critère du vrai culte », rejoint un thème que la tradition chrétienne, y compris réformée, a toujours reconnu. La Réforme n’a jamais opposé la foi et les œuvres, mais en a précisé l’ordre. Comme l’exprime la formule classique — attribuée à Luther, reprise par Mélanchthon1 et formulée aussi par Calvin — : « la foi seule justifie, mais la foi qui justifie n’est jamais seule » (Institution de la religion chrétienne, III.11.20).
Autrement dit, la foi véritable engendre nécessairement l’amour concret du prochain. Pour Calvin, les œuvres sont le fruit inévitable d’une foi vivante, non son complément ni sa condition. Ainsi, le souci des pauvres, du faible et du marginal n’est pas un ajout humanitaire au christianisme : il découle directement de la régénération du cœur par la grâce.
En ce sens, Dilexi Te exprime un accent biblique légitime : la compassion et la justice font partie de la vocation du peuple de Dieu. Le chrétien ne peut prétendre aimer Dieu s’il ferme son cœur à la détresse humaine (1 Jean 3.17).
2. La grâce première : fondement indispensable
Toutefois, la théologie réformée tient fermement à un ordre théologique que Dilexi Te évoque, mais dont elle souligne davantage la hiérarchie : la grâce précède la justice sociale.
Chez Calvin, la transformation du monde n’est pas un préalable au Royaume, mais une conséquence de la réconciliation accomplie en Christ. Ce n’est qu’un cœur justifié, libéré de la domination du péché, qui peut vraiment aimer et servir son prochain sans chercher à se justifier lui-même par ses œuvres.
Autrement dit, la lutte contre la pauvreté ne peut être comprise comme un moyen d’accomplir l’Évangile, mais comme son fruit. Le danger du « christianisme social » – déjà dénoncé par Kuyper – est de réduire la foi à un projet moral et politique, alors que la Réforme insiste sur le primat du salut individuel, du culte et de la Parole.
3. Abraham Kuyper et la souveraineté du Christ sur toutes les sphères
L’approche kuypérienne permet de recevoir Dilexi Te de manière constructive. Kuyper rappelait que « il n’est pas un domaine de la vie des hommes dont le Christ ne puisse dire : c’est à moi ! ».
Cette affirmation soutient l’idée que la foi chrétienne a des conséquences publiques : elle concerne aussi les structures sociales, économiques et politiques.
Ainsi, lorsque Dilexi Te évoque la nécessité de transformer les « structures injustes », un lecteur réformé peut y voir un écho du mandat culturel de la Genèse : administrer le monde selon la justice de Dieu. Le chrétien réformé ne sépare pas foi et société ; il reconnaît la vocation politique et économique du croyant.
Mais Kuyper ajoute aussi que chaque sphère (État, Église, économie, famille) possède sa souveraineté propre : l’Église ne doit pas devenir une agence sociale, ni confondre évangélisation et réforme des structures. Elle proclame la seigneurie du Christ, et c’est cette proclamation qui, progressivement, transforme la société.
4. La justice structurelle : oui, mais à la lumière de la chute
Léon XIV parle de « structures injustes » et de la « croissance d’élites riches ». Ce diagnostic peut être partagé, mais la théologie réformée rappelle que le mal ne réside pas d’abord dans les structures, mais dans le cœur humain (Jérémie 17.9). Les structures ne deviennent injustes que parce que des hommes injustes les façonnent.
C’est pourquoi la transformation sociale passe d’abord par la conversion personnelle et la régénération. Calvin et les Réformateurs ne séparaient jamais réforme de l’Église et réforme du monde : l’une nourrit l’autre. Sans la prédication de la Parole et la discipline ecclésiale, la charité devient un moralisme sans croix.
Le texte pontifical tend à parler d’un « engagement collectif » qui pourrait, dans certaines lectures, faire passer la foi au second plan. Une réception réformée insisterait donc sur la primauté de l’Évangile sur l’action, même si les deux demeurent inséparables.
5. Une convergence spirituelle, une divergence d’ecclésiologie
Enfin, Dilexi Te suppose une conception catholique de l’Église comme médiatrice du salut et agent principal du changement social.
La tradition réformée, tout en partageant l’appel à une Église humble et proche des pauvres, considère que le Royaume de Dieu ne s’identifie jamais à une institution visible. L’Église n’a pas le monopole du bien : Dieu agit aussi à travers la société civile, les vocations laïques et les institutions séculières.
Ainsi, dans la ligne de Kuyper, un protestant confesserait que la justice pour les pauvres n’est pas d’abord l’œuvre de « l’Église institutionnelle », mais celle des croyants dispersés dans le monde, témoins du Christ dans chaque domaine de la vie.
6. Synthèse
Dilexi Te exprime une vérité profondément chrétienne : l’amour du Christ pour les pauvres doit se manifester dans la vie de son Église.
La tradition réformée accueille pleinement cet appel, mais en le replaçant dans une hiérarchie théologique précise :
- la grâce avant la justice ;
- la régénération avant la réforme sociale ;
- le Royaume spirituel avant les structures terrestres ;
- la mission de l’Église avant son influence politique.
Dans cette perspective, Dilexi Te peut être lu comme un rappel providentiel de l’exigence d’amour, à condition de le recevoir non comme un programme socio-évangélique, mais comme un fruit de la grâce souveraine de Dieu, manifestée dans le Christ, Seigneur de toutes les sphères de la vie.
Conclusion
Il existe une tension permanente entre l’évangile social humaniste et l’évangile de la grâce souveraine.
La théologie réformée confessante reconnaît la noblesse morale de ce premier, mais affirme que le Royaume de Dieu ne se bâtit pas par la justice sociale, fût-elle évangélique : il se manifeste dans la proclamation du Christ crucifié et ressuscité, qui seul transforme les cœurs — et, par eux, le monde.
- La formule « La foi seule justifie, mais la foi qui justifie n’est jamais seule » est souvent attribuée à Calvin, mais elle vient en réalité de la tradition luthérienne.
Origine réelle :
Elle résume la pensée de Martin Luther, sans être une citation littérale de lui.
La formule exacte apparaît plus clairement chez Philippe Mélanchthon, dans la Confessio Augustana (1530) et surtout dans ses Loci Communes :
“Fides sola justificat, sed fides quae justificat non est sola.”
(La foi seule justifie, mais la foi qui justifie n’est pas seule.)
Cette phrase condense la théologie de Luther : la justification se reçoit par la foi seule, mais cette foi, vivifiée par l’Esprit, produit inévitablement les œuvres.
Chez Calvin :
Calvin exprime la même idée, mais avec d’autres mots.
Dans son Institution de la religion chrétienne, III.11.20, il écrit :
« Il est donc foi seule qui justifie ; et pourtant la foi qui justifie n’est jamais seule, mais accompagnée de bonnes œuvres. » ↩︎
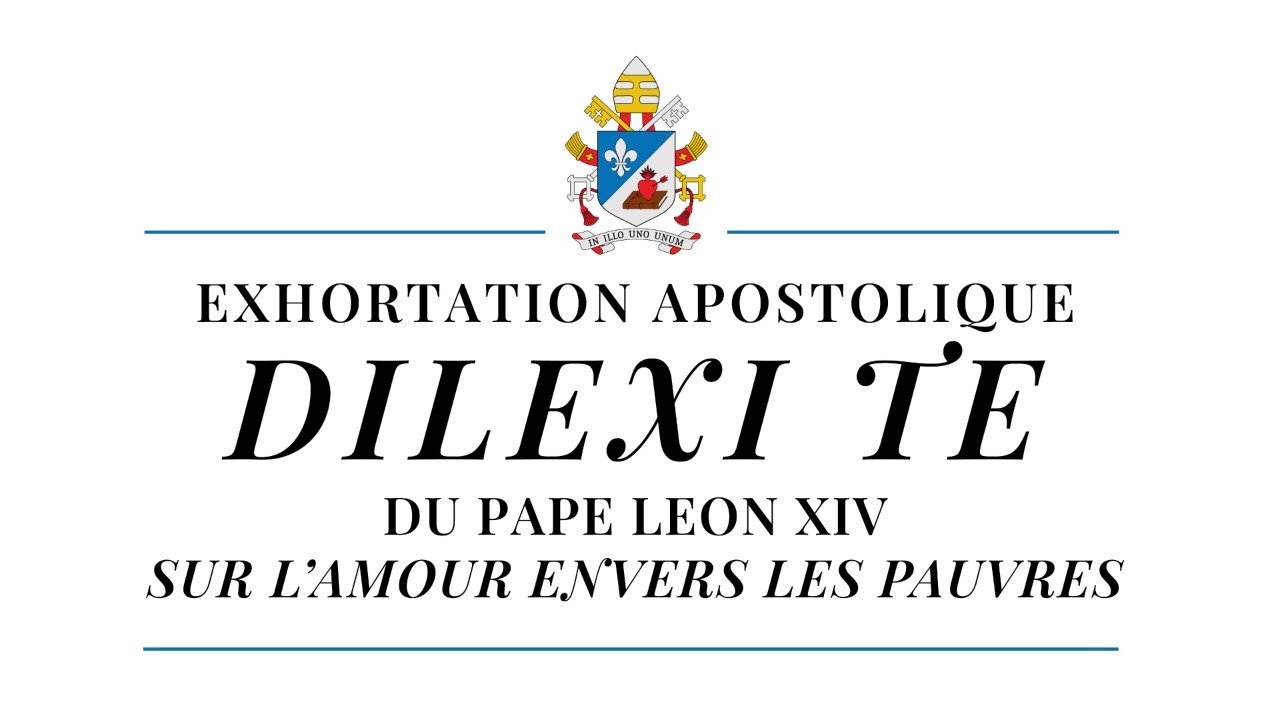
Laisser un commentaire