La Faculté réformée d’Aix-en-Provence, raison d’être et origines
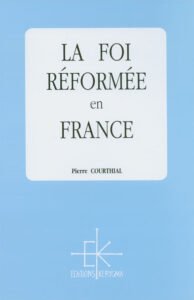
Ndlr : C’est nous qui soulignons, en gras.
« Si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat ? Si vous n’exprimez pas de votre langue une parole claire, vous parlerez en l’air. »
1 Co 14.8–9
Nous examinerons successivement :
- Le contexte historique spécifique constitué par l’histoire du protestantisme réformé en France ;
- La confession de la Foi comme raison d’être fondamentale de la Faculté ;
- Les proches origines de celle-ci.
I. Le contexte historique
« Les Églises réformées en France » adoptèrent unanimement, en 1571, au synode tenu à La Rochelle, une confession de Foi en 40 articles qui reprenait, en en corrigeant et précisant définitivement le texte, une confession datant d’un synode réuni clandestinement, et au risque du martyre, à Paris, en 1559. Cette Confession de La Rochelle, cette confessio gallicana (confession française) – que nous désignerons, pour abréger, comme la Gallicana– demeure aujourd’hui encore, en droit sinon en fait, « la véritable confession de Foi des Églises réformées en France » puisque aucun synode national régulier de celles-ci ne l’a rejetée ou modifiée, alors même que beaucoup (d’Églises, de pasteurs et de membres) l’ont hélas ! abandonnée.
L’article 5 de la Gallicana affirme avec assurance et vigueur ce point fondamental à propos de la sainte Écriture :
« Nous croyons que la Parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine et qu’elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes.
Cette Parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut ; il n’est donc pas permis aux hommes, ni même aux anges, d’y rien ajouter, retrancher ou changer.
Il en découle que ni l’ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles, ne peuvent être opposés à cette Écriture sainte, mais qu’au contraire toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d’après elle. »
Gallicana, article 5
Les Églises réformées en France, comme les Églises des tout premiers siècles, avaient été établies sur le fondement de la Parole de Dieu et cimentées par le sang de leurs martyrs. Aussi s’étaient-elles multipliées et affermies pendant quelques décennies. Mais les malheureuses « guerres de religions », le plus souvent provoquées, d’un côté comme de l’autre, par des chefs politiques avides de pouvoir, puis, ensuite, l’Édit de Nantes de 1598, mal ficelé par Henri IV puisqu’il faisait du protestantisme « une confession religieuse désavantagée mais un corps social et politique privilégié »[2] , et, enfin, les déviations doctrinales propagées par l’Académie de Saumur à partir de 1630, déviations qui portaient atteinte à la grâce libre et souveraine de Dieu affirmée dans la Gallicana (articles 8, 12, 17, 18, 20), vont aboutir à la terrible crise (crisis en grec = jugement) que sera la révocation de l’Édit de Nantes, par Louis XIV, en 1685. Considérablement diminué par le départ en exil d’un grand nombre de ses meilleurs éléments, décapité par l’exode ou le martyre de ses pasteurs et docteurs, dilué dans une clandestinité obligée, le protestantisme réformé français ne s’est jamais remis du coup qui lui fut alors porté. Il y aura certes, grâce à Dieu, un « reste fidèle » qui tiendra bon, malgré les galères, les prisons, les exécutions, la claustration dans des couvents, pour les forcer à rejoindre l’Église catholique-romaine, d’un grand nombre de femmes et d’enfants. Mais ce qui reste du protestantisme réformé français va trop souvent dériver par rapport à la sainte Écriture et à la confession de la Foi et sombrer soit dans l’arminianisme[3], soit dans l’illuminisme[4].
Par la suite, l’influence des prétendues « Lumières », aggravée par la Révolution, le pénétrera pour le rationaliser, le libéraliser et le politiser. Et il y aura encore les suites du Concordat signé par Napoléon Bonaparte en 1801. En effet, les Articles organiques, promulgués par le Premier Consul en 1802, vont embourgeoiser un protestantisme déjà bien mal en point : les réformés vont dépendre d’un ministère des Cultes et être répartis en Églises consistoriales, de 6.000 membres chacune, dirigées par des « consistoires » comptant, à côté des pasteurs, et souvent au-dessus, six à douze notables choisis parmi les réformés payant le plus d’impôts ! Le Réveil[5], dans la première moitié du XIXe siècle, pénétra heureusement certains milieux de l’Église nationale ; il contribua aussi à la création d’Églises « libres »[6], puis d’Églises « méthodistes ».[7]
Depuis 1685, la Foi confessée par la Gallicana – comme aussi par l’ensemble des confessions réformées des XVIe et XVIIe siècles : la Belgica, les XXXIX articles de l’Église d’Angleterre, les catéchismes de Genève et de Heidelberg, la Seconde confession helvétique, les Canons de Dordrecht, les textes de Westminster, etc. – n’est plus guère gardée en France. S’il y a encore un « protestantisme » à géométrie variable, il n’est plus – ou presque – de protestantisme « réformé » au sens « confessant » et historique du mot.
Les « libéraux », penchant vers le rationalisme, rejettent ouvertement la Foi réformée. Et ceux qu’on appelle, ou qui s’appellent, par opposition, « orthodoxes » n’en prennent, le plus souvent, et en individualistes, que ce qu’ils veulent bien choisir d’en prendre. Tout cela est d’évidence jusque dans les Facultés de théologie[8].
Le dernier synode national normal des Églises réformées en France s’était réuni à Loudun en 1659. Antoine Court[9] avait, non sans peine, réussi à assembler un synode extraordinaire, dans une vallée du Vivarais, en 1726 (3 pasteurs, 8 proposants, 36 anciens ; au total 47 membres).
Il faudra attendre juin 1872 pour que puisse s’ouvrir à Paris, dans le temple du Saint-Esprit, rue Roquépine, un synode national ; deux cent treize ans après le synode de Loudun, non sans mal et non sans d’âpres discussions, les « orthodoxes », conduits par François Guizot, un laïc, ancien ministre et président du Conseil sous Louis-Philippe, évangélique convaincu, réussirent à voter, à la majorité, une simple « déclaration de foi », dont Auguste Lecerf [10] a écrit qu’elle était « sans couleur bien discernable et que n’importe quel arien[11], socinien[12] ou arminien (aurait pu) accepter[13]».
Peu à peu, le, protestantisme réformé (au sens large) français, déjà divisé entre Église nationale, Églises libres et Églises méthodistes, va se trouver encore davantage divisé parce qu’à l’intérieur de ces trois divisions ecclésiastiques il va y avoir la division entre « orthodoxes » et « libéraux ». Par ailleurs, l’Église nationale va bientôt se trouver divisée, « ecclésiastiquement » entre les synodaux qui ont voté la déclaration de foi de 1872 (les « orthodoxes ») et les « libéraux » qui, après avoir refusé de voter la déclaration de foi, vont se tenir à l’écart. Les choses deviendront manifestes lorsque, après la loi de séparation des Églises et de l’État (1905), les « orthodoxes », au synode général d’Orléans, en 1906, vont constituer l’Union des Églises réformées évangéliques, les plus nombreuses ; tandis que les « libéraux », lors d’un synode constituant réuni à Paris, en 1907, vont constituer l’Union des Églises réformées.
En réalité, ces deux Unions d’Églises n’ont, pas plus l’une que l’autre, fait retour à la confession de Foi qu’avaient gardée les Églises réformées en France et leurs synodes aux XVIe et XVIIe siècles. Dans l’une comme dans l’autre, comme aussi dans les Églises libres et les Églises méthodistes, règne un pluralisme plus ou moins arbitraire. C’est ainsi que le pasteur Auguste Lecerf, surnommé « le dernier des calvinistes » sera banni de l’Union des Églises réformées évangéliques (« orthodoxes ») parce qu’il prêchait la divine élection, et sera appelé et accueilli chaleureusement par l’Union des Églises réformées (« libérales ») !
En 1932, Lecerf écrivit que cet « état de choses désolant » commençait à « se modifier ».
« Nous espérons que nous pourrons, quelque jour, parler de la renaissance du calvinisme dans la vie ecclésiastique et universitaire … La cause réelle du déclin … doit être reconnue dans ce que l’école de Karl Barth appelle l’humanisme. Pour éviter certaines confusions, nous dirons plutôt l’anthropocentrisme ». Et il concluait : « Nous devons ranimer, dans tous les domaines, l’esprit du calvinisme. A tout prix, Dieu doit être mis en possession de son droit. La raison humaine, le moralisme humain, le sentimentalisme lui-même doivent être trainés, comme des captifs, derrière le char triomphal du Christ vainqueur. Et l’homme, en tant que rival de Dieu et que juge de Dieu, doit être du tout (= entièrement) anéanti. »[14]
Dans les années Trente du XXe siècle, dans les dix années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, les espoirs de Lecerf semblèrent se réaliser.
Trois courants, apparemment convergents, ne cessaient de se renforcer dans le protestantisme réformé français, appelés, semblait-il, à renverser tant le modernisme que le pluralisme :
- le courant calviniste, animé par Auguste Lecerf ;
- le courant revivaliste, animé par les « Brigadiers de la Drôme » ;
- le courant barthien, animé par le pasteur Pierre Maury.
A. Le courant calviniste, animé par Auguste Lecerf
Né à Londres en 1872, ayant grandi dans un milieu de « Communards », ces révolutionnaires qui avaient fui la France après l’écrasement de la Commune de Paris en 1871, et qui étaient pour le moins détachés du christianisme, Lecerf fut converti à la lecture « fortuite » d’abord du Nouveau Testament, puis, à Paris, de l’Institution chrétienne de Calvin, découverte à l’étalage d’un bouquiniste. Frappé par la Vérité, ayant reçu vocation de pasteur, s’étant fait baptiser malgré l’opposition de sa famille, Lecerf entra, à 17 ans, à la Faculté de théologie protestante de Paris. Il y soutint, à 23 ans, une thèse sur Le déterminisme et la responsabilité dans le système de Calvin. Suivirent dix-neuf années de ministère dans plusieurs paroisses de Normandie, quatre années de guerre comme aumônier militaire. Puis, revenu à Paris comme directeur de la Société biblique, il profita de leçons de grec et d’anglais, qui lui furent confiées à la Faculté de théologie protestante, pour faire connaître la Foi réformée aux étudiants venant de plus en plus nombreux à ses cours libres et à ses entretiens. Après la publication de ses deux thèses de licence et de doctorat en théologie (qui forment les deux volumes de son Introduction à la dogmatique réformée), il devint professeur titulaire. Et, de plus en plus connu tant à l’étranger qu’en France, appelé à faire des cours et des conférences sur la Foi réformée, il eut la joie de voir venir à celle-ci un nombre croissant d’hommes et de femmes, particulièrement dans la jeunesse. Il mourut en 1943 sans avoir vu la Libération de sa patrie, mais en en ayant été toujours certain. En France et en Suisse romande, nombreux furent les disciples de Lecerf, parmi lesquels son fils spirituel Pierre Marcel qui lança, en 1950, La Revue Réformée.
B. Le courant revivaliste, animé par les « Brigadiers de la Drôme »
Dès 1922, dans la Drôme, le témoignage de jeunes réformés convertis, d’une petite Église de montagne, bouleversa le jeune pasteur Edouard Champendal (1895–1972) qui, sur le tas, refit sa théologie non sans luttes douloureuses : « J’appris à mettre ma théologie sur l’autel ». Une petite équipe de pasteurs, dont Jean Cadier, plus tard professeur de dogmatique à la Faculté de théologie protestante de Montpellier, constitua « la Brigade missionnaire de la Drôme ». Des « missions de réveil », des « conventions chrétiennes » se succédèrent alors dans plusieurs pays francophones (France, Suisse romande, Belgique, Algérie). Revenus carrément à la Foi réformée, les « brigadiers » firent connaître celle-ci par Les cahiers du Matin vient et les éditions du Matin vient. Ce labeur fut à l’origine du « Groupe missionnaire de Gardonnenque », dans les Cévennes, ainsi que des Conventions d’Anduze. La Foi réformée était retrouvée par les animateurs de ce Réveil.
C. Le courant barthien, animé par le pasteur Pierre Maury
En 1934, Pierre Maury fut nommé pasteur de l’Église réformée de l’Annonciation, à Paris. Disciple et ami de Karl Barth, il s’employa à faire connaître et rayonner la pensée conquérante de celui-ci.
La doctrine barthienne apparut d’abord comme une néo-orthodoxie et un retour authentique à la Foi réformée. Lecerf, dans ce premier temps, saluait en Barth « un prophète », qui revenait à l’Écriture, à Calvin, aux docteurs réformés des XVIe et XVIIe siècles. Venu à Paris, en 1934, Barth fit à la Faculté de théologie protestante plusieurs cours sur la Gallicana.[15]
Le Congrès « calviniste », tenu à Genève du 15 au 18 juin 1936, marqua à la fois la rencontre et la rupture des calvinistes et des barthiens : la rencontre, puisque, entre autres, Peter Barth, frère de Karl, et Pierre Maury y vinrent ; la rupture puisqu’il apparut clairement que les néo-orthodoxes étaient plutôt des néo-modernistes et ne revenaient à la Foi réformée :
- ni sur la question de la divine élection ;
- ni sur la question de la foi qui ne serait « qu’un mouvement, qu’une tension entre désespoir et confiance » ;
- ni surtout sur la question de l’autorité divine du texte inspiré de la sainte Écriture affirmée dans la Gallicana.
A ce Congrès genevois de 1936, les trois courants dont j’ai parlé étaient particulièrement bien représentés : Lecerf était là ; Cadier était là ; Maury était là ; chacun avec des amis, des frères. Mais les trois courants ne vont pas concourir ensemble à la restauration de la Foi réformée. Le tournant vers la Foi réformée qu’avait tant espéré Lecerf est manqué.
Dans les années qui ont précédé l’Assemblée constituante pour l’unité de l’Église réformée de France, tenue à Lyon en mai 1938 (J’y fus, à 23 ans, le plus jeune député !), de nombreux pasteurs et laïcs, tant de l’Union des Églises réformées que de l’Union des Églises réformées évangéliques, avaient souhaité, préparé, cette unité, à des degrés divers. Lecerf n’était-il pas dans une Union d’Églises considérée comme « libérale » ? Des hommes comme Lecerf et Cadier étaient par ailleurs convaincus – à tort, hélas ! – que le modernisme était blessé à mort et allait bientôt disparaître. En étant comme un « levain » dans la « pâte » ecclésiastique, ces calvinistes comptaient contribuer à cette disparition. Dans les débats des années Trente, beaucoup se fixèrent plus sur le souci d’unité que sur le souci de vérité. Le « Qu’ils soient un comme nous sommes un ! » de la prière sacerdotale fit quelque peu oublier le contexte incontournable de cette demande : « Sanctifie-les par la vérité. Ta Parole est la vérité ! ». Par ailleurs, pas plus ceux qui étaient pour l’unité proposée que ceux qui étaient contre, ne mirent en avant la confession de Foi qu’est la Gallicana. La déclaration de foi de 1938, votée par les pour, la grande majorité de l’Assemblée, ne vaut guère mieux, dans son ambiguïté voulue, que celle de 1872 qui va être revendiquée par les contre de la petite Union des Églises réformées évangéliques, qui subsistera mais qu’on obligera à se dire, en plus, « indépendantes ». Si une majorité des députés venus des Églises libres et méthodistes se ralliera à la nouvelle Union des Églises réformées, quelques-unes d’entre elles s’y refuseront, et subsistent toujours aujourd’hui.
Incapable, spirituellement et en conscience, de reprendre avec conviction la Gallicana, la nouvelle Union des Églises réformées (I’E.R.F.) va peu à peu démontrer, au long des décennies, que le sacro-saint pluralisme unitaire est son dogme et critère fondamental. Des pasteurs pourront librement croire ou non que la sainte Écriture est la Parole de Dieu, croire ou non en la Sainte Trinité, croire ou non en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ; croire ou non à la réalité du jugement dernier et à la séparation des « sauvés » et des « perdus » ; honorant le pluralisme unitaire, ils seront sans souffrance à leur place dans l’E.R.F. Par contre si, tout en subissant le pluralisme unitaire, vous en rejetez le dogme et adhérez de tout cœur à la Gallicana, à la Foi confessée par « les Églises réformées en France », vous aurez à porter une souffrance par l’Église autrement dure à porter que la souffrance pour l’Église[16]. Mon ami Pierre Marcel, pasteur de l’E.R.F. et justement proposé par la commission académique de celle-ci comme professeur à la Faculté de théologie protestante de Paris, vit sa candidature rejetée par un synode national au mépris de tous les usages ; et la commission académique désavouée n’eut pas assez de courage et d’honneur pour démissionner. Il est vrai que Pierre Marcel était l’héritier spirituel de Lecerf, qu’il avait écrit des ouvrages authentiquement « réformés », et qu’il avait eu le front de publier, en français moderne, la Gallicana ! Les tenants autoritaires du dogme pluraliste, en particulier au sein de la Commission des Ministères, ont fait preuve, bien d’autres fois, d’intolérance, trouvant insupportables les réformés confessants qui n’avaient que le tort de confesser la Foi des Églises réformées en France, et acceptaient, cependant, de porter la croix qu’était pour eux l’état de fait pluraliste de leur Église.
La petite mais vaillante Union des Églises réformées évangéliques (« indépendantes » ! ne l’oublions pas) s’apercevra vite que toute forme de pluralisme, même atténuée, ronge toute Église n’ayant pas une nette confession de la Foi et une « discipline »[17] fermement appliquée. Ses meilleurs, ses plus fidèles éléments, virent peu à peu, non sans tristesse et scandale, leur Faculté de théologie protestante d’Aix-en-Provence en venir à se déchirer en doctrines opposées ; ses professeurs, opposés les uns aux autres, la quitteront peu à peu.
II. La confession de la Foi
Afin d’éviter un possible malentendu, je demande au lecteur de vouloir bien noter la distinction que je fais, dans cet exposé, entre la confession de la Foi et telle(s) ou telle(s) confession(s) de Foi (par exemple, le Symbole des Apôtres ou la Gallicana). Les confessions de Foi des six premiers conciles dits oecuméniques et celles de la Réformation – fidèles les unes et les autres à la Parole de Dieu qu’est la sainte Écriture – ont jalonné, développé, précisé et approfondi LA CONFESSION DE LA FOI qui, ainsi, a progressé de manière homogène, au long des siècles, sous la conduite de l’Esprit Saint. La confession de LA FOI a toujours été, et demeure, la première mission de l’Église (« notre Mère », disait Calvin, Inst. Chrét. IV.1, 1 et 4) et des fidèles. Et, puisque la Foi de l’Église et de ses fils et filles est une (Ep 4.5), le pluralisme est, principiellement, en contradiction avec la confession de la Foi, et, par conséquent, avec les confessions de foi historiques fidèles à l’Écriture, même s’il « se réfère » à elles, ce qui n’engage pas à grand chose.
Pluralisme et pluralité
Mais avant de poursuivre notre propos et afin qu’il soit bien clair que la confession de la Foi est la raison d’être fondamentale de la Faculté réformée d’Aix-en-Provence, il convient de bien distinguer pluralisme et pluralité.
Pluralité
A. La pluralité est non seulement conciliable avec l’unité, mais elle est constitutive de celle-ci ; exactement comme l’unité est constitutive de la pluralité.
Seule la Foi chrétienne est à même, en théologie, en philosophie, en politique, en sociologie, dans les sciences, etc. de montrer comment échapper, soit à la réduction moniste à l’Un, soit à la confusion pluraliste, à la dispersion, en Multiple.
Les problèmes de l’Un et du Multiple, qui sont posés en toute réalité et en toute pensée, ne peuvent être dominés, éclairés et en voie d’être résolus, que par la Foi chrétienne, elle-même une et plurielle, établie par le Dieu Un et Pluriel, qui est la Trinité sainte du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En Dieu, l’Un n’est pas plus fondamental que le Multiple et le Multiple n’est pas plus fondamental que l’Un. Le Dieu Un est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le Dieu Un. Le mot Trinité (Tri-unité) signale à la fois l’Un et le Multiple qu’est le Dieu vivant et vrai, le Dieu de la sainte Écriture, le Dieu de Jésus-Christ.
L’univers (le mot signale à la fois l’un et le divers) que le Dieu trinitaire a créé, maintient et gouverne, est un ensemble un et pluriel.
De même, l’Écriture sainte, « soufflée de Dieu », souverainement, par le ministère d’hommes que Dieu a choisis, préparés, conduits infailliblement à cet effet, est une et plurielle.
De même, encore, la sainte Église de Dieu, l’Église Corps de Christ, manifestée pleinement en chaque Église locale authentique (Parole, Sacrements, discipline), est une et plurielle.
Pluralisme
B. Le pluralisme, à l’inverse, tend toujours à détruire la vraie unité plurielle parce qu’il veut mêler en une pseudo-unité non pas des complémentaires divers, cohérents et homogènes, mais des contradictoires, incohérents et hétérogènes.
La foi et la Foi
A la distinction du pluralisme et de la pluralité, qui s’opposent, il faut ajouter la distinction de la foi (avec un f) et de la Foi, qui ne doivent pas être opposées.
Nos vieux théologiens, qui ne planaient pas dans le vague, distinguaient, selon l’Écriture, la fides qua creditur, la foi personnelle par laquelle on croit, et la fides quae creditur, la Foi objective qui est crue parce que révélée.
Quand, par exemple, la Bible nous rapporte qu’Abraham eut foi dans le Seigneur, que Jésus dit : Ayez foi en Moi, ou qu’Étienne était un homme plein de foi, il s’agit de la fides qua creditur, de la foi personnelle par laquelle on croit.
Mais quand, par exemple, la Bible nous rapporte que Paul et Barnabas exhortaient les disciples à demeurer dans la Foi, que les Églises devenaient plus fortes dans la Foi, et quand saint Paul parle de « la Foi qui nous est commune à vous et à moi » ou qu’il affirme qu’il n’y a qu’une seule Foi, ou quand saint Jude parle de « la Foi transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude 3), il s’agit de la fides quae creditur, de la Foi objective qui est révélée et enseignée, progressivement, à la sainte Église de Dieu, par l’Esprit Saint s’exprimant par l’Écriture-Parole de Dieu.
Vers une Faculté réformée confessante
Après la IIe Guerre mondiale, et surtout à partir des années Soixante, quand ils virent les protestants réformés français invités à toutes sortes d’hérésies doctrinales et morales par de mauvais conducteurs et docteurs, des pasteurs et des fidèles, souffrant de plus en plus du dogme pluraliste qui leur pesait comme un joug insupportable et couvrait et justifiait ces hérésies, reçurent et partagèrent la conviction que leurs Églises devaient redevenir confessantes, ou mourir. La claire et nette confession de la Foi était désormais pour eux – comme elle aurait à devenir pour les Églises et la mission de celles-ci – l’exigence première de l’adoration et de l’obéissance dues au Seigneur (Mt 5.13–16 ; Lc 9.26 ; Ep 4.13–16 ; Hé 3.1 et 4.14). Il ne pouvait s’agir, bien sûr, d’imposer à quiconque la confession de la Foi puisque, selon Jésus, « ce que déclare la bouche, c’est ce qui déborde du cœur », mais il fallait appeler les protestants réformés français, et d’autres avec eux, à découvrir ou à redécouvrir, comme par une conversion, la Foi confessée en France et ailleurs aux XVIe et XVIIe siècles et scellée, alors et bien souvent, par le sang des martyrs.
Dans « un état de choses désolant », pour reprendre l’expression de Lecerf en 1932, pourquoi ne pas « relever » la Gallicana pour qu’elle soit reconnue vraie et suivie ? Cette Gallicana que les synodes des Églises réformées et réformées évangéliques n’avaient jamais osé écarter ou modifier, mais à laquelle ils s’étaient « référés » ? Aussi, comme nous le verrons dans la troisième partie de cet exposé, l’idée d’un « centre » réformé, puis celle d’une « Faculté de théologie » réformée, reprenant comme fondement la Gallicana et, au-delà, la confession de la Foi, va germer dans les esprits d’un certain nombre dès la fin des années Soixante, puis sortir au jour au début des années Soixante-dix.
Il était normal, il allait de soi, de reprendre en acte d’adoration et de glorification du Dieu trinitaire, Seigneur, Créateur et Sauveur, en acte d’obéissance de la foi à la Foi, la Gallicana plutôt qu’une autre des confessions de la Réformation si belle soit-elle, ou plutôt que d’en rédiger une nouvelle ; d’abord parce que nous étions en France, patrie de la Gallicana et surtout parce qu’il n’appartient régulièrement qu’à une Église ou qu’à un synode (ou Concile) d’Églises de « dresser » une confession de Foi. Ayant en vue la fidélité retrouvée des Églises réformées en France à la confession de la Foi, ne fallait-il pas commencer, après près de trois siècles, par revenir au point d’où l’on s’était écarté de plus en plus de la Voie du Seigneur, pour reprendre enfin celle-ci ?
La tradition et la Tradition
Quiconque, avec les pluralistes, n’identifie pas l’Écriture comme vraie et infaillible Parole de Dieu (alors que les Pères, les Docteurs et les Réformateurs de l’Église l’ont fait ; alors et surtout que l’Écriture s’identifie elle-même comme telle), ne peut voir dans les confessions de Foi des premiers siècles, et dans celles de la Réformation, que des documents successifs et hétérogènes dont les derniers peuvent effacer et remplacer les précédents, et ne peut recevoir ce que dit l’Écriture de la (ou des) tradition(s).
Car, ici encore, il convient de distinguer la tradition (avec un t), au mauvais sens du mot, la tradition des Pharisiens et des scribes qui, selon Jésus, annule la Parole de Dieu (Mt 15.1 et 6), la tradition des hommes qui, toujours selon Jésus, abandonnent le commandement de Dieu (Mc 7.8), la tradition du judaïsme pour laquelle saint Paul avait eu, alors qu’il était encore Saul, un zèle excessif (Ga 1.14) ; à la Tradition (avec un T), au bon sens du mot, la Tradition apostolique que les chrétiens doivent retenir, garder, et selon laquelle ils doivent vivre (2 Th 2.15 et 3.6). Cette Tradition apostolique (= le Nouveau Testament) fait suite à la Tradition biblique d’avant notre ère (= l’Ancien Testament) que l’ancienne Église (= Israël) a transmise (« traditionnée ») au peuple de Dieu à partir de Moïse (cf. Ex 19.3 ; 2 R 17.13 ; Ps 78.3–6 ; soit un texte de la Loi, un texte des Prophètes et un texte des Écrits).
Au total, la Tradition biblique (La Loi + les Prophètes + les Écrits + le Nouveau Testament transmis par le cercle apostolique : apôtres et prophètes – cf. Ep 2:20) constitue inséparablement ce que l’Église doit, à son tour, fidèlement transmettre (=« traditionner » !). En grec, tradition = paradosis et transmettre paradidômi sont des mots d’une même racine, de même étymologie.
Aussi, peut-on et doit-on parler, en un sens bon et nécessaire, de la Tradition ecclésiale qui transmet, traduit, applique fidèlement, au long des siècles et sous la conduite du Saint-Esprit, la Tradition biblique, sans rien lui ajouter ou retrancher, mais en l”« intelligeant » (= en la lisant en profondeur) toujours mieux. La Tradition biblique, la Foi transmise aux saints une fois pour toutes, ne cesse pas, ainsi, d’être confessée au long des siècles, par la Tradition ecclésiale, lorsque celle-ci est fidèle à celle-là.
Traditio e Scriptura fluens
Nos vieux Docteurs parlaient avec justesse de la Traditio e Scriptura fluens, de la « Tradition découlant de l’Écriture ». Il faut préciser cependant que la Tradition ecclésiale doit toujours être critique, c’est-à-dire qu’elle doit toujours vérifier et montrer que ce qu’elle transmet est bien le contenu de sens du texte de cette sainte Écriture qui, seule, est infaillible parce qu’elle est Parole de Dieu, Règle, pour toujours, de la Tradition, de la Foi, ecclésiale.
La Gallicana et le Sola Scriptura
La Gallicana, dans sa fidélité à l’Écriture, entend bien se situer dans la Tradition ecclésiale qui doit progresser selon la Norme divine qu’est l’Écriture, l’Écriture seule, Sola Scriptura. C’est ainsi que sur les points majeurs que sont la doctrine de la sainte Trinité et la doctrine de la personne divine et des deux natures (divine et humaine) de notre Seigneur Jésus-Christ, la Gallicana confesse en son article 6 et en ses articles 14 et 15 :
« Cette Écriture Sainte nous enseigne qu’en la seule et simple essence divine que nous avons confessée, il y a trois Personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit :
- le Père, cause première, principe et origine de toutes choses,
- le Fils, sa Parole et sa Sagesse éternelle,
- le Saint-Esprit, sa force, sa puissance et son efficace.
Le Fils est éternellement engendré du Père ; le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils.
Les trois Personnes de la Trinité ne sont pas confondues mais distinctes ; elles ne sont pourtant pas séparées, car elles possèdent une essence, une éternité, une puissance identiques, et sont égales en gloire et en majesté.
Nous acceptons donc, sur ce point, les conclusions des Conciles anciens, et repoussons toutes les sectes et hérésies qui ont été rejetées par les saints docteurs, comme saint Hilaire, saint Athanase, saint Ambroise et saint Cyrille. »
Gallicana, article 6.
« Nous croyons que Jésus-Christ, étant la Sagesse de Dieu et son Fils éternel, a revêtu notre chair afin d’être Dieu et homme en une même personne et, en vérité, un homme semblable à nous, capable de souffrir dans son corps et dans son âme, ne différant de nous qu’en ce qu’il a été pur.
Quant à son humanité, nous croyons que le Christ a été l’authentique postérité d’Abraham et de David quoiqu’il ait été conçu par l’efficacité secrète du Saint-Esprit.
Ce faisant, nous rejetons toutes les hérésies qui, dans les temps anciens, ont troublé les Églises. »
Gallicana, article 14.
« Nous croyons qu’en une même Personne, à savoir Jésus-Christ, les deux natures sont vraiment et inséparablement conjointes et unies, chacune d’elles conservant néanmoins ses caractères spécifiques, si bien que, dans cette union des deux natures, la nature divine, conservant sa qualité propre, est restée incréée, infinie et remplissant toutes choses, de même que la nature humaine est restée finie, ayant sa forme, ses limites et ses caractères propres.
En outre, quoique Jésus-Christ, en ressuscitant, ait donné l’immortalité à son corps, nous croyons toutefois qu’Il ne l’a pas dépouillé de la réalité propre à sa nature humaine.
Nous considérons donc le Christ en sa divinité de telle sorte que nous ne le dépouillons point de son humanité. »[18]
Gallicana, article 15.
A la fin de son article 5 sur l’autorité de l’Écriture, dont nous avons cité, plus haut,le commencement, la Gallicana, démontrant ainsi son attachement volontaire et sans réserves à la Tradition ecclésiale fidèle à l’Écriture, déclare :
« Nous reconnaissons les trois Symboles, à savoir
parce qu’ils sont conformes à la parole de Dieu ».
Gallicana, article 5.
Comme en témoignent les enseignements des Réformateurs et des Docteurs réformés confessants – il est facile de le vérifier par l’Institution chrétienne de Calvin, pleine de citations des Conciles et des Pères –, les Églises réformées et leurs pasteurs, fidèles à l’Écriture-Parole de Dieu, ont reconnu les décisions des six premiers Conciles dits « oecuméniques » (Nicée, 325 ; Constantinople I, 381 ; Éphèse, 431 ; Chalcédoine, 451 ; Constantinople II, 553 ; Constantinople III, 680–681).
« Nous recevons volontiers les anciens Conciles, comme de Nicée, de Constantinople, le premier d’Éphèse, Chalcédoine, et les semblables qu’on a tenus pour condamner les erreurs et opinions méchantes des hérétiques ; nous leur portons, dis-je, honneur et révérence, en tant qu’il appartient aux articles qui y sont définis. Car ces Conciles ne contiennent rien qu’une pure et naturelle interprétation de l’Écriture que les saints Pères, par bonne sagesse, ont accommodé pour renverser les ennemis de la chrétienté. »
Jean Calvin, Inst. Chr. IV.IX.8.
Mais les Réformateurs et les réformés confessants, par fidélité à l’Écriture-Parole de Dieu, ont rejeté, et rejettent toujours, les décisions du second Concile de Nicée (787) exigeant que soit rendu un culte aux images saintes, aux icônes. Et Calvin d’ajouter justement :
« Les images ont tenu bon dans les églises. Mais saint Augustin dit que cela ne peut se faire sans péril d’idolâtrie. Épiphane, plus ancien docteur, parle encore plus rudement puisqu’il dit que c’est méchanceté et abomination de voir des images aux temples des chrétiens. »
Id. 9.
Autrement dit, les décisions des Conciles et les enseignements des Pères de l’Église ancienne et des Docteurs du Moyen Âge sont tels que :
« Nous nous éloignons modestement quand nous trouvons qu’ils amènent quelque chose éloignée des Écritures ou contraire à celle-ci. Et ne pensons ce faisant leur faire aucun tort vu que tous, en accord, défendent d’égaler leurs écrits aux Livres canoniques (= bibliques), mais ordonnent qu’on les teste pour savoir s’ils s’accordent ou discordent d’avec ceux-ci, nous exhortant à recevoir ce qui s’y accorde et à rejeter ce qui est discordant. »
La seconde confession hélvétique, chap. 2.
Ainsi le précise, en son chapitre 2, La seconde confession hélvétique, de 1566, que le Synode de La Rochelle de 1571, le Synode de la Gallicana, reconnut solennellement, la faisant ainsi sienne.
Le mot « catholique »
Il convient d’ajouter, à l’usage des protestants français qui liront cet exposé, que les réformés confessants des autres Églises que celles de France emploient – comme le faisaient les réformés français des XVIe et XVIIe siècles – sans hésitation, en bonne part, le mot catholique, comme, par exemple, en parlant de la Foi catholique ou en disant avec le Symbole des Apôtres et/ou le Symbole de Nicée : « Je crois l’Église catholique ».
En fait – nous allons le voir – dire, à la place, la Foi universelle ou je crois l’Église universelle n’est pas la même chose et c’est opérer une réduction de sens.
Le mot grec katholicos vient, en effet, de la juxtaposition de deux mots : kath = selon, et holos = le tout. Si, réduit à son sens quantitatif, le mot « catholique » signifie soit « selon le tout spatial », universel ; soit « selon le tout temporel », continuel, perpétuel, permanent, « Je crois l’Église catholique » signifie alors soit « Je crois à l’universalité de l’Église », soit « Je crois à la continuité, à la perpétuité, de l’Église » ; mais là, n’est ni le plus important, ni l’essentiel. Au sens qualitatif, qui est le sens principal et prioritaire, entraînant le sens quantitatif, spatial ou temporel, « catholique » signifie « selon le Tout de la Révélation normative qu’est, pour l’Églises la sainte Écriture ».
Nous devons, certes, croire à l’universalité de l’Église dans l’espace, et à la continuité et perpétuité de l’Église dans le temps, mais nous devons croire, d’abord et surtout, à la catholicité de l’Église de Dieu dont la première obéissance est d’être, et de rester fidèle à la totalité de la parole de Dieu.
Lorsque saint Athanase se trouvait solus contra mundum, seul face au monde – et à l’Église universelle ! – (avec quelques-uns tout de même), c’est lui qui, était catholique, en affirmant fermement, « selon le tout de l’Écriture », la divinité de la Personne de Jésus-Christ, consubstantielle à la Personne du Père, vraiment Dieu et vraiment homme, alors que l”« univers », qui l’entourait et le persécutait sans relâche, était hérétique, évêques en tête, puisqu’arien.
Être « catholique », c’est respecter le tout inséparable du texte de l’Écriture, dans l’adoration de Celui qui en est l’Auteur premier et souverain ; c’est refuser de « choisir » dans l’Écriture ; c’est refuser l’hérésie(en grec l’aïresis= le choix ; du verbe aïretizô – àl’aoriste : héretisa – = choisir).
Aussi le « SOLA SCRIPTURA » (= la norme, c’est LA SEULE ÉCRITURE) doit-il être accompagné du « TOTA SCRIPTURA » (= la norme, c’est L’ÉCRITURE DANS SA TOTALITÉ). Selon l’Écriture sainte, pas plus (SOLA), pas moins (TOTA).
Le mot opposé au mot catholique est le mot hérétique. Et vice versa.
Nos frères séparés catholiques-romains ne peuvent et ne doivent nous empêcher de nous dire catholiques. Nous devons être – et sommes, en principe – plus « catholiques » qu’ils ne le sont, puisqu’ils ajoutent à la sainte Écriture une prétendue « révélation-tradition apostolique », qui leur permet, au long des siècles, de parasiter la Tradition découlant de l’Écriture par des traditions, non seulement sans fondement dans l’Écriture sainte, mais opposées à celle-ci et, du même coup, l’étouffant et la déformant. Choisir dans l’Écriture est hérétique. Mais choisir ailleurs est aussi hérétique. S’il ne faut rien retrancher, il faut aussi ne rien y ajouter. Cela a été dit par le Seigneur aussi bien à l’ancienne Église qu’était Israël qu’au nouvel Israël qu’est l’Église (Dt 4.1–2 ; 13.1 ; Ec 3.14 ; Pr 30.5–6 ; Ap 22.18–19). l’Église ne peut avoir barre sur l’Écriture, laquelle, étant la Parole-même de Dieu, domine l’Église jusqu’à ce que passent le ciel et la terre (Mt 5.17ss).
Dans le contexte où prétend régner aujourd’hui le dogme pluraliste – hors l’Église ou dans l’Église –, n’importe qui choisit, comme il lui plait, de croire sinon n’importe qui et n’importe quoi, du moins, dans les Églises, ce qu’il veut dans l’Écriture sainte : le Nouveau Testament, pas l’Ancien ; les Évangiles, pas saint Paul ; l’Évangiles, pas la Loi ; les paroles « douces » de Jésus, pas ses paroles « dures », les paroles concernant le salut, pas celles concernant la perdition ; ce que peuvent approuver la « raison », ou « les sentiments », ou la « modernité », pas les miracles, les interdictions et les jugements ; ce que les historiens jugent vraiment « historique », pas ce qu’ils désignent comme « mythique », ou « légendaire », etc.
Les réformés confessants, avec les Pères, les Docteurs, les Réformateurs de l’Église, depuis le temps des Apôtres jusqu’à nos jours, reçoivent toute l’Écriture comme Parole-Loi et Parole-Évangile de Dieu. Même au prix d’un rude combat intérieur au bout duquel il faut bien se rendre.
Ils savent quelle est la patience de Dieu envers le pas à pas de leur propre existence et le pas à pas de l’histoire de l’Église. Ils savent aussi l’aide que Dieu leur apporte et a apportée à l’Église par des messagers, anges et/ou hommes. Pour le progrès de la doctrine ecclésiale fidèle à la Révélation, il a fallu, entre autres,
- Tertullien (155 ‑222) pour la doctrine de la Trinité,
- Athanase (295–373) pour celle de la Personne et des deux natures du Christ,
- Augustin (354–430) pour la doctrine de l’homme,
- Anselme (1033–1109) pour celle de l’expiation,
- Luther (1 483‑1546) pour la doctrine de la justification par la foi,
- Calvin (1509–1564) pour celle de l’autorité souveraine du Dieu trinitaire[22].
Découlant de la catholicité ecclésiale, il y a une continuité et une universalité ecclésiales dans la transmission, dans la Tradition, de la Foi une et plurielle (et non pluraliste !) par les confessions établies solidement, au moins quant à l’essentiel, sur la seule Écriture, sur toute l’Écriture.
Le Dieu Souverain
Il convient d’être très attentif au fait remarquable, et trop peu remarqué, que
- l’enseignement des six premiers Conciles dits « œcuméniques », avec le progrès qu’il exige dans l’Église et dans le monde,
- et l’enseignement des confessions de Foi de la Réformation, avec le non moindre progrès qu’il exige, lui aussi,
ont un thème fondamental commun, à savoir que le seul Seigneur-Sauveur pour les personnes humaines, leurs libertés, leurs diverses sociétés et les diverses sphères de leur existence est le Dieu trinitaire, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la sainte Écriture, le Dieu qui a créé toutes les réalités visibles et invisibles de l’univers, qui les garde et sur lesquelles il règne souverainement, selon sa justice et son amour.
Oui, c’est bien cela que les premiers Conciles ont affirmé en enseignant, selon la Parole de Dieu, que le Sauveur Jésus-Christ est vraiment Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit, et non pas seulement vraiment homme. Et c’est bien cela aussi que, suivant la même ligne de fidélité à la Parole de Dieu, les confessions de Foi de la Réformation ont affirmé en enseignant qu’il n’y a de salut temporel et éternel, pour les hommes, que par la seule grâce souveraine de Dieu et dans leur reconnaissance fidèle de l’autorité seigneuriale de Dieu parlant par toute l’Écriture.
Nous sommes, sans doute à la veille d’une troisième époque, d’un troisième temps fort, au cours duquel l’Église va devoir confesser sa Foi en la seigneurie du Dieu Créateur et Sauveur. La foi de l’humanisme (= religion de l’Homme se faisant dieu), avec ses Révolutions tricolore, brune et rouge, ses États-providence, tous plus ou moins totalitaires, ses camps d’extermination, ses millions d’avortements et d’exclusions, au mépris des devoirs des hommes, s’écroule sous les décombres qu’elle ne finit pas d’accumuler. Vient le temps où l’Église réveillée, réformée, reconstruite, devra cesser de s’aligner sur le consensus ambiant pour confesser la Foi à laquelle Dieu l’appelle par sa Parole, son Évangile et sa Loi.
Il vient, le temps où toute pensée va être amenée captive aux pieds de Jésus-Christ, en sciences comme en philosophie, en économie comme en politique, dans la vie des individus comme dans les familles, les nations, les entreprises humaines légitimes de toutes sortes.
Il vient, le temps où l’Église va prendre à cœur les dernières paroles de Jésus avant son ascension :
« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc :
Faites disciples toutes les nations, les baptisant au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici : Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
Matthieu 28
Faculté de théologie réformée d’Aix-en-Provence
S’accorder à la Gallicana, inscrite elle-même dans l’ensemble, un et pluriel, des confessions de Foi de la Réformation et, avec celles-ci, dans la suite reconnue des affirmations des premiers Conciles, c’est non pas se recroqueviller sur sa « petite religion à soi »[23], mais s’ouvrir à la tradition ecclésiale découlant de l’Écriture-parole de Dieu ; c’est s’ouvrir à la Foi catholique attestée par les Pères des premiers Conciles et les confessions de Foi de la Réformation.
C’est la prise de conscience de l’antithèse entre la confession de la Foi et le dogme pluraliste qui a conduit les réformés confessants des Églises réformées et réformées évangéliques à imaginer, puis à établir, la Faculté de théologie réformée d’Aix-en-Provence, d’abord pour glorifier le Dieu trinitaire en suivant sa Parole, ensuite pour travailler au progrès de la Foi réformée, en particulier dans les pays francophones, enfin pour préparer des pasteurs et, s’ils le veulent, des fidèles, joyeux dans la liberté de confesser « la Foi transmise aux saints une fois pour toutes ».
Cet établissement d’un centre d’études supérieures, résolument « réformé confessant » dans chacune des disciplines enseignées par ses professeurs titulaires, est un événement depuis plus de trois siècles, en France. C’est à la grâce et au jugement du souverain Seigneur que nous nous remettons, grâce et jugement qui exigent, au long d’un rude combat, fidélité, prière, labeur, amour de l’Église et d’autrui, persévérance et indéfectible espérance.
III. Les proches origines
Dans les années Quarante, Cinquante et au début des années Soixante, il y eut à Aix-en-Provence la Faculté de théologie protestante des Églises réformées évangéliques (indépendantes !). Cette Faculté vit de 1948 à 1962, ses professeurs anciens ou nouveaux la quitter, en suite de désaccords théologiques et/ou, parfois de questions personnelles ;
Avec un certain courage et obstination, le pasteur Pierre Verseils, nommé, faute de doyen, vice-doyen, va maintenir quelque vie à la Faculté, en assurant, avec l’aide de quelques professeurs venant du dehors, un minimum de cours à deux ou trois étudiants, et en organisant des rencontres ainsi que des sessions de « recyclage » théologique pour pasteurs et fidèles.
En 1967, avec le départ de P. Verseils bien découragé, c’est apparemment la fin de la Faculté protestante d’Aix. Si, de facto, il n’y a plus de Faculté, vont subsister « l’Association cultuelle pour l’entretien » et le « conseil » de la Faculté. De jure, la Faculté existe toujours. Et la propriété et les bâtiments de la Faculté demeurent.
Des pasteurs et laïcs des E.R.E.I. – ainsi désignerons-nous désormais, pour abréger, les Églises réformées évangéliques (indépendantes !) –, tels les pasteurs Jean Bordreuil, Pierre Guelfucci, André Tholozan, l’amiral Sap, le procureur général Vercier et bien d’autres, qui avaient vaillamment combattu pour la fidélité de leurs Églises à la sainte Écriture, sont douloureusement éprouvés tant par le désordre doctrinal qui se développe en leur sein que par la « fin » de leur Faculté. A côté des pasteurs « réformés évangéliques » authentiques, ont été progressivement nommés dans les paroisses, pour boucher les trous dus à la mort ou à la mise à la retraite de pasteurs, des pasteurs non réformés venus de milieux évangéliques, n’ayant parfois pas fait d’études de théologie.
Tant et si bien que, dès 1967, le pasteur André Tholozan, président de la Commission permanente des E.R.E.I., écrit à M. Eugène Boyer, alors pasteur, après son père, d’une Église à York, en Pennsylvanie, pour lui demander d’aider à la réorganisation de la Faculté d’Aix en trouvant, aux États-Unis, des professeurs « calvinistes » introuvables en France.
E. Boyer, selon son habitude, ne répond pas. Mais ce pasteur-évangéliste américain, qui a déjà consacré de longues années de son ministère à notre pays qu’il aime profondément, pense en son cœur à la demande d’A. Tholozan et prie pour un exaucement.
Au début de 1968, E. Boyer, se rendant de Philadelphie à Détroit, rencontre inopinément (et providentiellement), dans un taxi les conduisant de l’aéroport de Détroit à la ville, le professeur Edmund Clowney, du Séminaire réformé de Westminster à Philadelphie. Ils ne s’étaient encore jamais vus. E. Boyer, qui ne connaissait pas de professeurs calvinistes et ignorait jusqu’à l’existence du Westminster Seminary, rencontre un professeur calviniste, co-formateur de professeurs calvinistes, qui, de surcroît, aime la France et connaît l’histoire du protestantisme dans notre pays. Une demi-heure d’échanges passionnés s’ensuivit.
La même année, le Docteur Clowney, venu en France, va donc visiter la Faculté d’Aix. Les bâtiments de celle-ci ont été utilisés à des activités mal définies qui n’ont pas peu contribué à la détérioration des locaux. Au cours du même voyage, E. Clowney, sur l’invitation d’A. Tholozan, se rend à une rencontre pastorale E.R.E.I. La diversité doctrinale incroyable des pasteurs présents corrobore l’inquiétude toujours croissante de M. Tholozan. Conclusion de E. Clowney à E. Boyer après sa visite de la « Faculté » et cette « pastorale » : « C’est épouvantable… il faut que tu y ailles ! »
Tout s’enclenche et va s’accélérer désormais.
Un nouveau fait providentiel survient. En cette fin de la même année 1969, M. Pierre Filhol, nommé intendant universitaire à Aix-en-Provence, arrive dans cette ville, avec sa femme, Renée. M. et Mme Filhol avaient déjà habité Aix de 1963 à 1966. P. Filhol avait été alors conseiller presbytéral de l’Église réformée évangélique, mais ni lui, ni Renée, n’avaient eu de rapports avec la Faculté.
A l’automne 1969, Eugène et Charlotte Boyer – lui est salarié par une « Mission » américaine – arrivent enfin à Aix. Charlotte Boyer, arrivée la première dans un appartement de la Faculté qu’ils vont occuper pendant dix ans, est désolée par l’état lamentable des lieux.
Bien vite, les Filhol, qui avaient connu l’évangéliste E. Boyer lors d’une mission d’évangélisation à Toulouse en 1957, vont faire équipe avec les Boyer. P. Filhol, devenu membre du « conseil de Faculté », va fermement appuyer le ministère d’E. Boyer. Renée Filhol et Charlotte Boyer vont faire, elles, un gros travail de nettoiement et de remise en ordre des locaux.
En 1971, au cours d’un voyage aux États-Unis, E. Boyer, aidé et conseillé par le Docteur Clowney, cherche des professeurs calvinistes pour Aix. S’il essuie un refus courtois de William Edgar, alors aumônier d’artistes, il rencontre pour la première fois deux étudiants anglais, Paul Wells, alors en deuxième année d’études au Westminster Seminary, et Peter Jones, qui achève son doctorat en théologie à Princeton et va devenir le gendre de Clowney.
Sous l’impulsion d’Eugène Boyer et de Pierre Filhol, qui commencent à avoir leur « petite idée » sur la future Faculté, s’organisent, dès 1971, des « cours décentralisés » de théologie à Aix bien sûr, et aussi à Marseille et à Nîmes (il y en aura plus tard à Alès). Enseignent ces cours, en dogmatique Bill Clark (des éditions calvinistes « Grâce et Vérité ») ; en Ancien Testament, le pasteur Émile Nicole ; en théologie pratique, Eugène Boyer ; en histoire et sociologie, François Gonin, pasteur alors de l’Église réformée évangélique à Aix, qui va, lui aussi, jouer un grand rôle dans l’établissement de la Faculté réformée.
Le 6 février 1971, Pierre Filhol était devenu président du conseil de Faculté, et, lors d’une réunion entre représentants de la commission académique des E.R.E.I. et membres du comité directeur de l’association cultuelle propriétaire des locaux de la Faculté (y viennent, entre autres, Pierre Filhol, Eugène Boyer et les pasteurs Guelfucci, Longeiret et Tholozan), une reprise de la Faculté est envisagée … si l’on trouve les professeurs calvinistes nécessaires !
Eugène Boyer et Pierre Filhol, ces deux « pères » de la prochaine Faculté réformée, vont être rejoints, en 1972, par le troisième « père » : Paul Wells.
Pendant tout ce temps préparatoire, des groupes aînés et cadets de réformés-confessants font leur apparition dans les Églises réformées (E.R.F.).
Lorsque Paul Wells, ayant obtenu sa maîtrise au Westminster Seminary, se décide à « aller voir » la Faculté, à Aix (il a écrit, des États-Unis, à Eugène Boyer, et n’a pas eu, évidemment de réponse), il rencontre, en gare de Marseille, Bill Clark qui lui dit : « Avec les E.R.E.I., vous ne pourrez jamais rien faire. C’est une cause perdue au départ. Ne restez pas à Aix. Vous perdrez votre temps ». C’est lui, cependant, qui conduira à Aix, en voiture, Paul Wells ! Il y avait, pourtant, dans les propos de Bill Clark quelque chose de juste que les trois « pères » de la Faculté réformée comprendront avant d’autres : il n’était pas possible, ni juste, de refaire une Faculté des seules E.R.E.I. Il n’était pas possible d’ignorer qu’il y avait des calvinistes, des réformés confessants dans l’E.R.F., à commencer par le fils spirituel de Lecerf, Pierre Marcel, animateur de La Revue Réformée, lequel se battait, depuis avant la IIe Guerre mondiale, pour la Foi réformée, et avait une audience et renommée internationales, en particulier aux Pays-Bas et dans les pays anglo-saxons.
Paul Wells et sa femme Alison vont finalement décider, à l’appel pour une année, puis trois ans plus tard, à l’appel définitif du conseil de Faculté, de rester à Aix. E. Boyer et P. Wells, efficacement aidés par Mme Jean Vercier, vont commencer alors par reclasser et réinstaller la bibliothèque et procurer à celle-ci de nouveaux ouvrages indispensables. Ils vont, avec Pierre Filhol, passer l’année 1972–73 à convaincre les dirigeants des E.R.E.I. de la nécessité d’une Faculté « autonome » par rapport à leur Union d’Églises, et à trouver les professeurs qu’il faut pour cette Faculté, tout en poursuivant et développant les « cours décentralisés » auxquels viennent des pasteurs, des conseillers presbytéraux et des fidèles.
Ce sera, de la part des E.R.E.I., une preuve de désintéressement, de foi et de sain réalisme que d’accepter finalement l’autonomie de la future Faculté réformée, tout en la laissant disposer, gratuitement, des lieux dont l”« Association cultuelle pour l’entretien de la Faculté » (Association faisant partie des E.R.E.I.) était propriétaire. Au Synode national et général des E.R.E.I., tenu à Ganges en Mai 1973, Pierre Filhol, au cours du rapport sur la Faculté dont il était chargé, déclara nettement que la structure autonome de la Faculté devait être confortée pour que celle-ci : « apparaisse comme une unité d’enseignement originale et accueillante, au service de tous ceux qui se rattachent au même courant théologique réformé… (La) discipline (concernant l’homogénéité de l’équipe professorale) évitera, me semble-t-il, les errements anciens qui résultèrent de la coexistence, difficilement vécue, de divers courants théologiques au sein du corps professoral. » P. Filhol termina son rapport en citant la belle fin de l’article 5 de la confession de Foi de La Rochelle, par lequel j’ai commencé cet exposé. C’est seulement le Synode national tenu à Saint-Christol-lez-Alès, en avril 1974, à la suite d’un nouveau rapport de P. Filhol, qui fit le bon choix en acceptant l’autonomie de la Faculté réformée.
A la rentrée académique de 1973, un an avant l’ouverture officielle de la Faculté libre de théologie réformée d’Aix-en-Provence, il y eut « une rentrée avant la rentrée » de quatre ou cinq étudiants. Paul Wells enseigne à la fois l’hébreu, le grec et la dogmatique. François Gonin enseigne l’histoire et Eugène Boyer la théologie pratique. Peter Jones, docteur en théologie de Princeton, maintenant arrivé avec sa femme Rébecca, n’enseigne pas encore, mais commence à préparer ses cours à venir, tout en apprenant le français.
Au printemps 1973, Paul Wells était déjà venu à Paris pour rencontrer Pierre Marcel et moi-même. Pierre Marcel, trop atteint dans sa santé, ne pouvait accepter d’aller faire des cours à Aix, mais, par ses conseils et son esprit organisateur, il contribuera à la rédaction équilibrée des statuts de la nouvelle Faculté réformée.
Pendant la guerre, alors que j’étais pasteur E.R.F. (de 1941 à 1946 à La Voulte-sur-Rhône, en Ardèche), j’avais voulu prendre contact avec les Églises réformées évangéliques dont j’appréciai la volonté d’être fidèles à la sainte Écriture. C’est ainsi, par exemple, que je pris part à une « pastorale » E.R.E.I. tenue à Lézan et au cours de laquelle je fis la connaissance du pasteur Pierre Guelfucci.
Plus tard, alors que j’étais pasteur, à partir de 1951, de l’Église Réformée de l’Annonciation à Paris, mes rapports avec les réformés confessants des E.R.E.I. se développèrent. En 1967, nous donnâmes des cours, Henri Blocher[24], professeur baptiste calviniste, et moi-même, lors d’une session de « recyclage » pastoral organisée à Aix par Pierre Verseils. Cette rencontre, au cours de laquelle nous devînmes amis, conduisit à l’organisation immédiate de réunions régulières de « théologie évangélique » qui se tinrent dans la Maison de l’Annonciation, dépendant de notre paroisse du même nom, et où vinrent des réformés, des luthériens, des baptistes, des libristes, etc. ; puis à l’organisation, en mai 1968, au même endroit, d’un congrès de théologie évangélique (on entendait, au loin, les bruits consécutifs aux manifestations révolutionnaires du Quartier latin !) qui réunit plus de 150 personnes. Sur la même lancée, Henri Blocher, le baptiste calviniste, Marie de Védrines, des E.R.E.I., et moi-même, de l’E.R.F., publiâmes, à partir de mars 1970, la revue quasi mensuelle Ichthus,qui dura jusqu’en décembre 1986. Cette revue, dont le secrétaire était alors Paul Arnéra, organisa en 1980, aux arènes de Nîmes, une Fête de l’Évangile mémorable qui rassembla jusqu’à 17.000 personnes.
Henri Blocher, qui enseignait la dogmatique à la Faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, établie en 1965, m’entraîna à y donner un enseignement d’éthique, deux fois par mois.
Toutes ces relations établies entre des réformés confessants de l’E.R.F., des réformés confessants des E.R.E.I. et même des réformés confessants baptistes expliquent en partie pourquoi, en septembre 1973, je reçus, après une visite conjointe à Paris de MM. Filhol, Wells, Jones et Boyer, la lettre officielle de P. Filhol m’appelant, au nom du conseil de Faculté, à venir à Aix pour enseigner l’éthique et la théologie pratique.
Ce n’est cependant pas sans peine que nous quittâmes, en juin 1974, ma femme Hélène et moi, cette très chère Église réformée de l’Annonciation où nous étions depuis 1951, heureux cependant de trouver compréhension et soutien de nombreux paroissiens qui compteront aussitôt parmi les « Amis de la Faculté d’Aix ». Mes trois anciens co-pasteurs de l’Église réformée de l’Annonciation, Pierre Gagnier (de 1953 à 1967), Jean de Watteville (de 1967 à 1969) et Daniel Atger (de 1970 à 1974) ne cessèrent jusqu’à leur mort (P.G. en 1988, J. de W. en 1990, D.A. en 1988) de me témoigner leur compréhension, leur appui et leur affection.
La Faculté d’Aix fut solennellement inaugurée les 13 et 14 octobre 1974[25].
[1] Doyen honoraire de la Faculté libre de Théologie Réformée d’Aix-en-Provence, fondée en 1974.
[2] Cf. Émile G. Léonard, Le protestant français, 32.
[3] Les arminiens, disciples de Jacob Arminius (1560–1609), rejettent la souveraineté de l’élection et de la grâce divines et mettent en avant la prétendue « autonomie » de la liberté humaine. Le salut dépendrait alors, en fin de compte (de conte !), de la décision de l’homme.
[4] Les illuministes, ou « spirituels » comme ils aiment parfois se désigner, placent leurs « inspirations »à côté ou au-dessus de l’Écriture et de son autorité normative.
[5] Le Réveil de la première moitié du XIXe siècle, sous l’autorité de l’Esprit Saint parlant avec et par la sainte Écriture dont il est l’auteur premier, a secoué la plupart des Églises protestantes que menaçait alors le rationalisme libéral. Il leur a donné, ou rendu, une vision missionnaire conquérante, non seulement pour l’évangélisation des Nations, mais pour l’extension du Règne du Christ en tous domaines. Pour la France, il faut citer les noms des frères Frédéric Monod (1794–1863) et Adolphe Monod (1802–1856), deux des pasteurs du Réveil ; et remarquer la fondation, entre autres,
- en 1818, de la Société biblique de Paris,
- en 1822, de la Société des Missions évangéliques de Paris,
- en 1825, de la Société de prévoyance et de secours mutuels de Paris,
- en 1829, de la Société pour l’encouragement de l’instruction primaire (il y aura près de 700 écoles protestantes en France, en 1840),
- en 1831, de la Société des livres religieux de Toulouse, qui a publié des œuvres classiques réformées des XVIe et XVIIe siècles, dont l’Institution chrétienne, de Calvin.
[6] Les Églises libres ont été, à l’origine, des Églises réformées dressées en dehors de l’Église réformée dite « nationale » ou « concordataire » parce qu’elle dépendait de l’Etat. Leur synode constituant, réuni à Paris, date de 1849. Elles se disaient d’abord seulement « évangéliques » et n’ont pris qu’en 1883 l’épithète « libres ». Leurs membres faisaient « profession explicite et individuelle de la foi ».
[7] Les Églises méthodistes, nées en Grande-Bretagne au XVIIe siècle, furent introduites en France au début du XIXe siècle (pays de Caux et Orléanais). C’est John Wesley (1703–1791) qui avait parlé de « la méthode prescrite par la Bible ». Sous la Restauration, elles s’implantèrent dans plusieurs régions de France, surtout méridionales (Aveyron, Gard, Hérault, Lozère).
[8] La Faculté de Strasbourg, un temps la plus libérale et rationaliste, fut une Faculté universitaire française de 1803 à 1870, puis de nouveau à partir de 1919 (pendant la IIe Guerre mondiale, elle fut transférée provisoirement à Clermont-Ferrand).
La Faculté de Montauban, la plus orthodoxe (?), ouvrit ses portes en 1810, en place de l’ancienne Académie réformée qui avait existé de 1598 à 1659, puis transférée à Puylaurens, de 1659 à 1685. Transférée à Montpellier où elle a été inaugurée les 14 et 15 janvier 1920.
La Faculté de Paris, à l’origine héritière française de la Faculté de Strasbourg devenue allemande, a été établie au cours des années 1877–1879. Elle a été, et demeure, une Faculté mixte luthéro-réformée.
[9] Antoine Court (1696–1760) est une grande figure du protestantisme réformé en France. Consacré en 1718, il s’efforça d’en redresser les Églises, alors menacées par l’illuminisme et des sectes aberrantes. Il voulut donner aux Églises clandestines des pasteurs fidèles. Ainsi fut établi en 1726 un « séminaire », à Lausanne, qui forma ces pasteurs, sous la direction de Court.
[10] Je ne saurai trop recommander les deux volumes de l’Introduction à la dogmatique réformée et les Etudes calvinistes de Lecerf. Ces ouvrages, épuisés depuis longtemps, devraient être réédités. L’Introduction a été publiée par les éditions « Je sers », à Paris (le premier volume en 1932, le second en 1938) . Les Etudes ont été publiées, par les éditions Delachaux et Niestlé, en Suisse, en 1949.
[11] Les ariens tirent leur nom d’un clerc égyptien originaire de Libye, Arius (256–336). Les ariens rejettent la doctrine de la Trinité et celle de la divinité de Jésus. Dieu le Père est, seul, Dieu. Le Fils ne peut être qu’une créature ; sa filiation ne peut être qu’adoptive. L’Esprit saint est encore une moindre créature que le Fils. Pour l’Église, devenir arienne, c’était (et hélas ! c’est encore) faire passer la raison humaine au-dessus de l’Écriture-Parole de Dieu. Il y eut des conciles ariens. Et les ariens sont encore nombreux, non seulement parmi les laïcs, mais parmi les « ministres ordonnés » des Églises d’aujourd’hui. Saint Hilaire, en Occident, et saint Athanase, en Orient, luttèrent avec courage contre l’hérésie arienne, alors triomphante. La Gallicana ne les mentionne pas sans justes raisons, en son article 6.
[12] Les sociniens, disciples de Lelio Socini (1525–1562), sont d’abord des ariens rejetant les doctrines de la Trinité et de la divinité, consubstantielle à celle du Père, du Fils de Dieu Jésus-Christ ; de plus, ils rejettent la doctrine de l’expiation – selon Socini, la justice de Dieu ne pourrait exiger que le péché soit inexorablement puni.
[13] In Etudes Calvinistes, 130.
[14] id. 130, 132, 133.
[15] Cf. dans mon livre Fondements pour l’avenir, 17 à 41 et 89 à 119.
[16] Cf. Clérissac O.P., Le mystère de l’Église, où j’avais, dès 1931, noté ces deux souffrances pour et par l’Eglise.
[17] Toute Église de Dieu vit 1) d’une prédication et d’un enseignement fidèles de la Parole de Dieu, 2) d’une administration fidèle des Sacrements de Dieu et, par conséquent, 3) d’une « discipline » conforme à l’Écriture sainte veillant aux points 1) et 2) et appliquant, aux ministres ordonnés comme aux laïcs, les sanctions scripturaires indispensables.
[18] Il avait été justement précisé, au Concile de Chalcédoine, que l’union des deux natures (divine et humaine) du Christ est « sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation ». C’est bien ce que reprend, dans la fidélité à la sainte Écriture, notre Gallicana.
[19] Le Symbole est dit « des Apôtres », bien qu’il n’ait pas été écrit par eux, en ce sens qu’il résume fidèlement les écrits apostoliques.
[20] Le Symbole de Nicée est, en fait, le Symbole de Nicée repris et complété par le Concile de Constantinople 1. En Occident, il a été ajouté, au sujet du Saint-Esprit, à « qui procède du Père » les trois mots « et du Fils ».
[21] Le Symbole d’Athanase, d’origine latine et gauloise, n’a trouvé son texte définitif que tardivement (entre les VIe et IXe siècles). Il est conforme à l’enseignement ‒ lui-même conforme à l’enseignement biblique ‒ d’Athanase qui n’en est, évidemment, que le « parrain ». Toutes les bonnes éditions de la Gallicana, dont la dernière de Kérygma (1988), comportent en appendice, les trois Symboles.
[22] Je me suis servi librement, ici, de The Story of Theology, par R.A. Finlayson (Londres, Tyndale Press, 1965).
[23] Sous le Second Empire, le pasteur Athanase Coquerel fils n’a-t-il pas déclaré ‒ bien que portant le nom de saint Athanase ! ‒ « Il n’y a de sincère et de suffisante que la confession de foi qu’on se fait à soi-même » !
[24] Les Églises baptistes ont commencé à s’établir en France sous la monarchie de Juillet. Cinquante ans plus tard, Ruben Saillens (1855–1942) fonda à Paris l’Église du Tabernacle. Lui succéda son gendre Arthur Blocher, grand-père d’Henri Blocher. Les Églises baptistes (chaque Église locale étant autonome) ont bien, en commun, le baptême des seuls croyants et le rejet du baptême des enfants, mais ont, chacune, leur déclaration de foi plus ou moins orthodoxe (il n’en est point de « libérale »).
[25] Pierre Courthial a prononcé le discours inaugural sur le thème « Dérapages éthiques ». Son texte a été publié dans Etudes Évangéliques (1975:1,2) 10–25. Voir aussi la brochure des éditions Kérygma, La Foi en pratique (n.d.l.r).

Laisser un commentaire