– par Serge Oberkampf de Dabrun, dans Réforme 11-17 octobre 2007. [C’est nous qui soulignons en gras]
Nota bene : J’émets des réserves sur certaines positions de l’auteur dans les notes en bas de page, qui ne sont pas dans la ligne de la foi réformée classique, ce qui n’enlève rien à la pertinence de l’article sur le sujet.
Pour Serge Oberkampf de Dabrun, le libéralisme, à force de vouloir être accueillant à l’autre, se perd et devient flou.
Le libéralisme théologique a-t-il encore un avenir ?
Non. « Un club sympa sans avenir »
On imagine le dialogue suivant :
« Alors ainsi, vous êtes chrétien ?
– Oui, je suis protestant.
– Ah, très intéressant : calviniste ou luthérien ?
– Vous savez, depuis la Concorde de Leuenberg, où, en 1973, calvinistes et luthériens se sont reconnus pleine communion de chaire et d’autel, comme vous dites dans le catholicisme, ces distinctions n’ont plus guère de pertinence… en revanche, ce qui compte beaucoup pour moi, c’est mon appartenance au protestantisme libéral.
– Décidément, vous autres protestants, vous prenez plaisir à tout faire pour décourager ceux qui voudraient faire l’effort de vous comprendre ! Vous me rappelez l’histoire du noir qui s’assoit dans une synagogue et à qui son voisin demande s’il ne lui suffit pas d’être noir pour qu’il veuille en plus devenir juif… »
Plus sérieusement, il s’agit de se poser la question de savoir si se réclamer aujourd’hui du protestantisme libéral ne consiste pas à regarder l’avenir dans un rétroviseur. Le concept est daté et le mot, aujourd’hui, n’évoque plus ce qu’il signifiait il y a cent cinquante ans. A l’ère de l’ « agir communicationnel » cher à Habermas, à quoi bon se raccrocher à un vocable qu’il faut longtemps expliquer pour s’épargner d’inévitables contresens ?
Admettons cependant qu’un esprit bien disposé arrive au terme de son enquête et qu’il se propose de définir ce que sont aujourd’hui les protestants libéraux. Il arrivera au constat qu’il s’agit d’une nébuleuse d’individus que rapproche précisément l’idée qu’il convient d’être une nébuleuse pour être protestants comme ils l’entendent. Tout ce qui pourrait être soupçonnable de pensée unique ou d’obéissance ecclésiastique leur est haïssable.
Il y a ainsi de fortes têtes quasiment athées, des bultmanniens bon teint, des idéologues de la christologie d’en bas, des antitrinitaires, des zwingliens, des partisans de la théologie du Process, des sentimentaux et des rationalisants… Tous peuvent à bon droit se réclamer d’une part de l’héritage et ils conviennent que ce qui les réunit est un commun art de croire, où la question est essentielle et la réponse sinon accessoire, en tout cas toujours transitoire. Peut-on parler de théologie libérale au singulier ? Voilà qui est fort douteux.
Les protestants libéraux partagent aussi de solides aversions qui cimentent leur cohésion. Citons pêle-mêle : l’ecclésiologie romaine, le Symbole des Apôtres, la cène hebdomadaire et plus généralement tout ce qui serait rite trop habituel ou discipline trop stricte.
On note aussi très majoritairement chez eux le souci d’éviter la rupture avec les autres, croyants ou non, et la conviction que l’amour de Dieu Lui fait devoir de sauver tous les hommes.
Il y a toute raison de penser que de tels croyants existeront toujours au sein du protestantisme, et tant mieux. Mais faut-il pour autant qu’ils s’organisent en un courant, avec journal et paroisses de référence ? Certes, tout exclusivisme leur étant par nature étranger, il n’y a aucun risque de dérive sectaire. On peut s’interroger toutefois sur la pertinence d’un drapeau brandi sur un champ de bataille désert, voire utopique. L’orthodoxie, au sens du XIXe siècle, ces défenseurs d’un phare assailli par la déferlante de la révolution industrielle et des philosophies du soupçon (le fameux triptyque Marx, Nietzsche, Freud), n’existe plus1. Non pas tant que les libéraux aient, comme certains le revendiquent parfois, gagné la bataille. Leur croyance d’antan dans le « progrès » et leur optimisme sur l’homme n’ont pas résisté à la Grande Guerre. Surtout deux phénomènes expliquent que l’on est maintenant ailleurs.
Tout d’abord la mesure de l’opacité du langage qui a rendu caducs les débats sur la « lettre des formules »2. Ensuite et surtout la fin de l’hégémonie de l’Histoire comme critère de vérité dans la recherche biblique3. Cela dit, il n’est pas nécessaire pour exister qu’il y ait un adversaire.
A mon sens, le protestantisme libéral sera demain ce qu’il a toujours été : un mouvement minoritaire regroupant des intellectuels qui peuvent se permettre d’être attentifs à ce qui vient des marges et des parvis car ils sont assez équipés pour que leur centre ne titube pas. Le passé toutefois a montré qu’une surdose de libéralisme pouvait mener à un athéisme grinçant, il y a des exemples célèbres !
Leur préoccupation d’ouverture, qui les rend plus attentifs à l’accueil des convictions des autres qu’à l’expression des leurs, ce désir de dialogue avec tout et tous laissent une impression de flou, même s’il s’agit en fait de largeur d’esprit. Qui trop embrasse mal étreint. Il ne semble d’ailleurs pas qu’un grand souffle libéral gonfle les voiles des paroisses protestantes ni que cette étiquette soit de nature à faire croître les effectifs.
Mais il n’y a pas lieu de déplorer que des hommes et des femmes se retrouvent pour échanger et travailler ensemble, et forment ainsi une sorte de club dont je sais qu’il est chaleureux et sans exclusive. Mais il m’étonnerait que ce soit là qu’il faille chercher les matières premières de l’avenir du protestantisme.
Renoncer modestement à chercher Dieu partout, car Il risque fort alors de n’être plus nulle part. La théologie chrétienne doit reconnaître qu’elle occupe un champ défini, et donc qu’il y a quantité de domaines de la connaissance et de la culture où elle n’a rien à dire4. Cela ne signifie pas pour autant que les chrétiens doivent se désintéresser de ces domaines. Ils doivent seulement se rendre compte que leur foi ne les rend pas là différents des autres. Ceci permet aux chrétiens de se trouver plus détendus et de rester fraternels quand ils sont en désaccord sur des sujets où la théologie ne diffuse aucune lumière.
En revanche, là où elle a quelque chose à dire, elle se doit de le rendre intelligible, c’est-à-dire distinguable des autres discours, ce qui n’est pas facile dans la cacophonie ambiante.
Il s’agit de proclamer dans l’actualité le salut et la vie éternelle, bref, l’Évangile. Et que les libéraux le veuillent ou non, ce sera toujours un discours de rupture. On ne progresse pas vers l’Évangile, on change radicalement ou pas du tout.
Ndrl : Serge Oberkampf de Dabrun, que j’ai eu plusieurs fois l’occasion de rencontrer quand j’étais pasteur à Paris (jusqu’en 2006) a été pasteur jusqu’à sa mort de l’Église Réformée de France (voir ci-après pour une biographie). Il est décédé le 11 avril 2010. Personnellement, je ne le classerais pas, à proprement parler, dans le courant néo-calviniste, au même titre qu’un Pierre Marcel ou qu’un Pierre Courthial, et certains de ses propos ont clairement des relents barthiens. Il était néanmoins très proche et sympathisant de la Faculté Jean Calvin où il comptait de vrais amis, notamment notre ami commun Jean-Marc Daumas de Cornilhac. Il avait entamé une thèse sur Auguste Lecerf, mais ne l’avait pas terminée. Il m’avait remis l’ébauche de ses recherches, que j’ai toujours en ma possession. Il mérite d’être mentionné sur ce blog, notamment pour ses critiques acerbes à l’égard du protestantisme libéral.
Voir de cet auteur :
L’Évangile au risque de la parole : prédications (broché) – 4 juin 2006
Autres (Librairie Jean Calvin)
Vidéos :
Ci-après un article de Sébastien Fath à l’a suite l’occasion du décès du pasteur Serge Oberkampf de Dabrun :

Le pasteur réformé français Serge Oberkampf de Dabrun s’est éteint le dimanche 11 avril 2010 à l’hôpital Européen Georges Pompidou à Paris. Il était âgé de 61 ans, marié à Anne, et père de cinq enfants.
Le bulletin de l’Église réformée de Saint-Germain en Laye pour mars-avril 2010 annonçait qu’il présiderait le culte pour les dimanches 18 et 25 avril 2010 : c’est dire si sa disparition subite a pris tout le monde de court.
C’est aux États-Unis que Serge Oberkampf de Dabrun a vu le jour en 1948, dans la ville de New-York.
Après avoir effectué des études de sciences politiques et de théologie à Paris et Montpellier, il a exercé le ministère pastoral à Saint-Etienne (Loire), puis au Havre (Seine-Maritime). Il a été ensuite secrétaire général de la Société biblique française entre 1991 et 1997. Entre 1998 et 2008, il a marqué la paroisse réformée du Luxembourg à Paris de son pastorat innovant et énergique, avant de poursuivre son ministère à l’ERF de Saint-Germain en Laye.
C’est une figure importante du protestantisme français actuel qui s’en est allée. Au-delà du protestantisme, c’est un acteur de l’histoire du christianisme contemporain dans l’hexagone qui tire sa révérence.
A ce titre, l’historien rappellera qu’au fil de son ministère, Serge Oberkampf a marqué l’identité réformée française par un charisme enseignant plein de faconde, de substance et d’audace. Il était devenu une personnalité incontournable du protestantisme parisien, au travers d’un ministère pastoral exercé durant près de 11 ans dans la prestigieuse paroisse du Luxembourg, devenue en 2006 la paroisse de Pentemont-Luxembourg.
Engagements œcuméniques (évangéliques / catholiques)
Au-delà, il s’est signalé également par un engagement œcuménique multi-facettes sous le sceau de l’annonce évangélique.
D’abord en direction de la diversité protestante : de sensibilité évangélique, il fit longtemps le lien entre milieu réformé et monde évangélique, notamment au travers de son implication dans l’Alliance Evangélique de France (AEF).
Ensuite en direction des catholiques et des orthodoxes : ami de Monseigneur Rey, évêque de Fréjus, il avait signé avec lui un livre d’entretien roboratif intitulé L’insolence de l’Évangile, Allez et annoncez ! (S. Oberkampf, Mgr D. Rey, interrogés par Jacques Bonnadier, Marseille, éditions Onésime, 2007). Il y soulignait notamment son souci de contribuer, par le « ministère de la Parole », à un engagement accru des fidèles, déjouant la passivité de l’habitude.
« Le sens de notre combat aujourd’hui, c’est de faire passer les chrétiens de l’état de consommateurs – ils sont dans une société chrétienne, ils vont au culte ou à la messe, ils écoutent béatement le prêche – à celui d’acteurs, de preneurs de parole et c’est là un changement radical. »
S. Oberkampf, L’insolence de l’Évangile, Allez et annoncez !, p.148.
Retour à la visibilité du témoignage
Quand viendra le temps du recul et du bilan socio-historique, on retiendra aussi de Serge Oberkampf qu’il a été de ceux qui ont anticipé, quelques années avant que cela ne redevienne (en partie) à la mode, le « retour à la visibilité » protestante réformée, au travers d’une annonce explicite et prophétique du message chrétien, quitte à bousculer ou déranger certains.
Il plaidait, selon le titre de son recueil de publications publié en 2006, pour l‘Évangile au risque de la parole (Marseille, ed. Onésime, 2006).
Pour ma part, j’ai croisé plus d’une fois le sillage de cet homme dont on n’oubliait ni la stature, ni la voix et l’humour, ni les propos.
Si mes souvenirs sont bons, ma première rencontre avec lui date du 13 avril 2002, à l’occasion d’une conférence qu’on m’avait demandé de donner à Paris, en tant qu’historien, lors de l’assemblée générale de l’Alliance Évangélique de France. Plus récemment, il m’avait également invité à intervenir dans le cadre d’une table-ronde à l’église de Pentemont, le 26 mai 2006, puis, le 13 octobre 2007 (école alsacienne à Paris), à l’occasion des 150 ans de la paroisse réformée du Luxembourg.
A chacune de nos rencontres, j’avais pu apprécier son sens du débat, sa hauteur de vue et son hospitalité chaleureuse.
Art de la passerelle et rupture du prophète
N’hésitant pas à déplaire, quitte à oser le contre-courant, y compris par rapport aux collègues, Serge Oberkampf de Dabrun était pourtant très rarement déplaisant. Bien au contraire, nombreux sont celles et ceux (qu’ils soient d’accord ou non avec lui) qui saluent ses grandes qualités humaines, sa chaleur et sa générosité. C’est notamment le cas du président de la Fédération Protestante de France, le pasteur Claude Baty, qui regrette, dans un communiqué du 13 avril 2010, d’avoir perdu là un « ami ».
Dans l’hebdomadaire Réforme du 15 avril 2010, Antoine Nouis et Jean-Luc Mouton se réclament aussi de cette amitié tissée avec un « homme libre » (« A Dieu Serge ! », p.3).
Mélange complexe d’assurance et de prestance très HSP (Haute Société Protestante) et d’un esprit d’indépendance que n’aurait pas renié le « petit peuple évangélique », il réalisait cette synthèse très inhabituelle (car c’est souvent l’un ou l’autre) entre art de la passerelle et rupture du prophète.
Dans l’édito de mars-avril 2010 du bulletin de l’ERF de Saint-Germain en Laye, il écrivait ceci. Qu’on adhère au contenu ou pas, ce texte traduit l’espérance chrétienne qui le portait et, à ce titre, il contribue à comprendre le sens de son engagement :
« Ce que l’Évangile affirme, c’est que Dieu en Jésus-Christ ne supprime pas la souffrance et la mort mais s’y tient à nos côtés, et qu’un jour viendra où la défaite du Mal apparaîtra au grand jour.
Serge Oberkampf de Dabrun, mars-avril 2010, bulletin de l’ERF de Saint-Germain-en-Laye, p. 1 et 2.
Dieu donne par grâce, au sein des vicissitudes que connaît toute l’humanité quelque chose de plus que l’existence : la vie éternelle. L’existence du chrétien, comme celle de tous les hommes est aléatoire. Certains périssent à vingt ans, d’autres à 60, d’autres à 90. (…) Le résultat est qu’on ne peut rien fonder sur nos existences sauf l’urgence de trouver la Vie. »
- Ndrl : Je ne partage pas le point de vue de l’auteur ici. Le courant orthodoxe a évolué, certes, mais de là à dire qu’il a disparu, cela est évidemment exagéré. ↩︎
- Ndrl : Je ne partage pas du tout le point de vue exprimé ici. Il n’y a rien de caduque dans le hiatus entre l’orthodoxie, qui est attachée à la lettre des formules, et libéralisme théologique, qui lui ne s’y attache effectivement pas du tout. Pour une critique du pluralisme théologique voir en particulier, de Daniel Bergèse : L’obsession pluraliste. ↩︎
- Ndrl : Ce point en revanche me semble essentiel. La critique biblique (méthode historico-critique) prétendument scientifique que revendiquaient les libéraux du 19e siècle a perdu de sa pertinence. La rigueur scientifique n’est plus de son côté. D’ailleurs, l’a-t-elle jamais été ? ↩︎
- Ndrl : Cette dernière formulation n’est pas en pleine résonance avec la théologie calviniste classique qui estime, avec Abraham Kuyper qu’ « il n’est pas de domaine de la vie des hommes dont le Christ ne puisse dire « c’est à moi ! » ». Elle est donc à nuancer. ↩︎
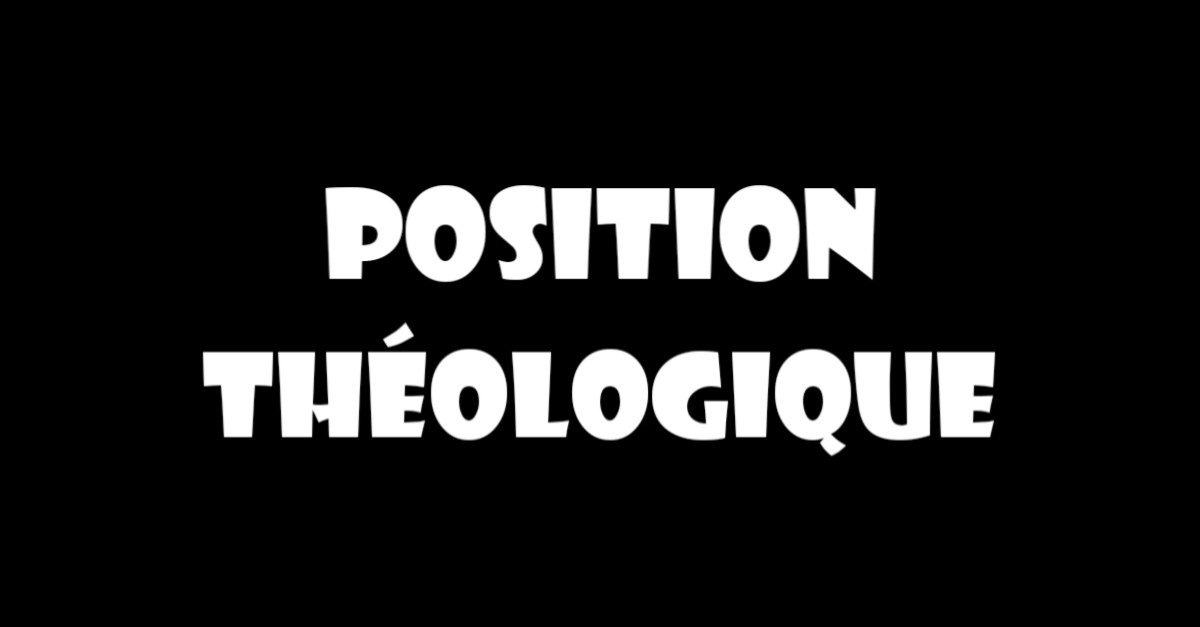
Laisser un commentaire