Pourquoi consacrer une rubrique sur ce blog réformé confessant au protestantisme moderniste ? La question doit être posée.
Pour quatre raisons principales :
1. La première c’est que cette composante du protestantisme existe, que cela nous plaise ou non, et non seulement elle existe mais elle occupe une place non négligeable au sein des églises historiques, réformées, luthériennes et anglicanes, notamment dans les chaires de théologie. C’est triste. Très triste même. Mais c’est là un fait incontestable. Un jour, il en sera autrement, c’est là notre prière. Mais aujourd’hui, il faut faire face.
2. La deuxième raison c’est que, comme dit le proverbe : « Mieux vaut prévenir que guérir » ! Est-il nécessaire de le dire ? Mentionner ne signifie pas cautionner. Mentionner c’est aussi d’une certaine manière prévenir. Certains chrétiens ont sans le savoir adoptés dans leur théologie, même prétendument évangélique, des conceptions libérales sans même en avoir conscience. Peut-être parce que personne ne les a prévenus ? On tombe plus facilement dans le trou qui se trouve sur le chemin si celui-ci est mal éclairé. Il faut donc toujours savoir de quoi l’on parle. C’est vrai aussi par exemple pour le catholicisme romain, ou pour toute autre composante du christianisme. Savoir de quoi l’on parle est l’un des éléments nécessaires pour pouvoir se forger de façon solide et argumentée une identité, pour savoir ce en quoi l’on croit, et ce aussi en quoi l’on ne croit pas. Car on se pose aussi en s’opposant…
3. Toutes les composantes du christianisme comportent des forces et des faiblesses et il est important d’avoir conscience de cette réalité. Le catholicisme romain trouve sa force dans son Magistère qui pose le cadre en dehors duquel on sort de l’orthodoxie – la droite façon de croire – et qui sert de boussole pour diriger l’âme croyante au milieu de l’océan déchaîné des idéologies. Le protestantisme, n’ayons pas peur de le dire, pèche par son individualisme et son subjectivisme. Le libre examen comporte certains risques. Le protestantisme ne s’est pas tristement illustré dans sa composante libérale sans raisons. Il y a ici une propension congénitale et naturelle à accueillir les idées nouvelles, même les plus folles, beaucoup plus facilement que dans les autres traditions. Pour pouvoir corriger ses faiblesses encore faut-il en avoir conscience, avoir conscience de ses faiblesses. Il n’y a pas de fatalité ! Le protestantisme doit apprendre de ses erreurs. Mais encore faut-il que ces erreurs soient identifiées clairement, identifiées et reconnues, puis combattues.
4. La quatrième raison est d’ordre apologétique. Les premiers siècles de l’aire chrétienne ont vu naître les Pères apologètes qui ont succédé directement aux Pères apostoliques. Leur tâche a consisté à montrer la pertinence de la Foi chrétienne face aux religions et aux philosophies païennes de leurs temps comme aussi face aux hérésies – les ennemis extérieurs et les ennemis intérieurs de l’Église.
Il y a donc une tâche semblable aujourd’hui face au défi que représente le néo-protestantisme. Il s’agit de montrer la pertinence de la Foi chrétienne historique et biblique dans un premier temps, et du protestantisme classique dans un second temps, face à toutes les attaques extérieures comme intérieures qu’ils subissent. D’autant que les questions posées sont souvent de bonnes questions auxquelles il faut savoir répondre avec honnêteté, avec en particulier celles posées par la méthode historico-critique. En théologie réformée on parlera plutôt de la méthode historico-rédemptive. Peut-on véritablement approcher le texte biblique comme n’importe quel autre texte de l’antiquité et de manière purement scientifique et rationnelle sans le dénaturer ? Il y a de quoi dire ici !
Il n’y a aucune raison d’avoir peur des résultats de la recherche scientifique dès lors que celle-ci est comme le dit Auguste Lecerf libérée de l’idéologie humaniste et évolutionniste :
« L’Église ne veut pas se passer de la science, parce que la barbarie est une forme du mal. Mais elle n’a rien à craindre d’une science libérée de l’idéologie humaniste et évolutionniste. » Et encore : « L’école calviniste contemporaine donne raison à Calvin. Elle conçoit l’intégrité dans ce sens que la Providence divine a pourvu à la conservation substantielle du texte sacré, dans la mesure suffisante pour que l’intégralité de la vérité dogmatique parvienne à l’Église, en vertu de ce principe de foi que Dieu ne nous manque jamais dans les choses nécessaires. » Et : « Nous concluons que la foi réformée qui confesse que l’Écriture est la Parole de Dieu et que c’est là, et là seulement, qu’il faut chercher cette Parole, peut et doit être réaffirmée et restaurée dans toute sa rigueur scientifique. Verbum dei manet in aternum. »
Op. cit.
Trois remarques importantes.
1. On peut noter des évolutions malheureuses en sein du christianisme moderniste (libéral, progressiste) notamment sur le plan éthique. Car l’éthique suit la doctrine. Quand on lâche la locomotive de la dogmatique alors les wagons qui suivent finissent aussi par s’arrêter, même si au départ ils roulent par la vitesse acquise, et c’est ce que l’on constate de plus en plus aujourd’hui, dans tous les domaines de la pensée et de la vie. Le vieux libéralisme qui a compté en son sein des personnalités hors du commun, n’était pas, par exemple, détaché de la piété ni de la morale (Wilfred Monod, Albert Schweitzer, Auguste Sabatier, etc.). Il en est, hélas ! tout autrement aujourd’hui. Simple constat. Le discours sur l’avortement, le mariage, l’éthique sexuelle, l’euthanasie, mais aussi les questions de la laïcité et des autres religions ont considérablement évolués chez les libéraux. Le libéralisme inclusif d’aujourd’hui n’a à cet égard plus grand chose à voir avec celui du 19e et du 20e siècle. Il s’est d’une certaine manière radicalisé, voire sécularisé.
2. Nous affirmons qu’il en va du protestantisme moderniste vis-à-vis du protestantisme classique comme de l’ombre et de la lumière : la vérité ressort d’autant plus clairement par contraste avec les contrefaçons. La vérité qui ne saurait être contrefaite. A ce titre, j’émets pour ma part l’hypothèse selon laquelle les éléments les plus positifs que l’on retrouve bel et bien dans tels ou tels courants du protestantisme contemporain se trouvent déjà dans la théologie réformée classique, et que les éléments négatifs ne sont en général que la résurgence de vieilles hérésies : « Rien de nouveau sous le soleil… »
La vérité est une et atemporelle. L’un des critères pour la reconnaître c’est la continuité historique. Nous voulons croire et penser avec les Pères de l’Église, avec les théologiens de l’Âge de la Foi, avec les Réformateurs et post-Réformateurs, les mouvements revivalistes de la mouvance évangélique des 19e, 20e et 21e siècle, et bien évidemment avec nos maîtres du renouveau calviniste en France et dans le monde, à commencer par Auguste Lecerf, Pierre Marcel et Pierre Courthial.
La continuité joue en notre faveur ! Il faut vraiment avoir conscience de cette réalité. Le libéralisme est un phénomène, en un certains sens, à la fois récent et anecdotique. Il ne fait pas partie de l’essence même du christianisme. C’est comme un corps étranger qui cherche par tous les moyens à se greffer sur le corps naturel, mais sans kjamais y parvenir out à fait. Il n’est par conséquent ni utile ni nécessaire qu’il s’y installe durablement, indéfiniment. Quand une greffe ne réussit pas, alors elle est rejetée, et rien ni personne n’y pourra jamais rien changer !
3. Ce qu’il faut bien comprendre c’est que tout système théologique repose sur des présupposés de foi et que ces présupposés ne sont pas les mêmes selon que l’on soit un réformé confessant ou un libéral.
Le présupposé fondamental de la Foi chrétienne historique c’est que la Bible est véritablement ce qu’elle prétend être, à savoir la Parole de Dieu – théorie de l’inspiration. Tout part de là. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle le premier article publié sur ce blog a été le suivant du professeur Auguste Lecerf : « Examen de la valeur du principe externe et formel de la foi réformée. Théorie de l’inspiration ». C’est la base, le commencement, le fondement de tout le reste. Impossible de se situer dans le paysage théologique sans avoir les idées claires sur ce sujet précis du statut de la Bible. Nous ne saurions jamais trop insister là-dessus ! Croire en l’inerrance de l’Écriture n’est pas quelque chose d’anecdotique et d’accessoire. C’est le point de départ, le roc sur lequel tout l’édifice théologique doit se construire. Et c’est impossible autrement.
Entendons-nous bien : Il est extrêmement difficile de mettre d’accord des théologiens qui n’ont pas les mêmes présupposés fondamentaux, et notamment celui du statut de l’Écriture.
Tout n’est pas affaire uniquement de rigueur intellectuelle et scientifique.
Au départ, c’est bien d’une question de foi dont il s’agit : on y croit, ou pas !
Aussi, ce qui est demandé à tous ceux qui sont véritablement en quête de la vérité, c’est d’abord de lire la Sainte Écriture, en entier, ensuite par exemple le Catéchisme de Heidelberg, l’Institution de la religion chrétien de Calvin, la Confession de Foi de La Rochelle, avant même de se plonger dans des lectures d’ouvrages plus récents.
La conversion (metanoia) de la pensée passe par cet effort initial : il s’agit d’aller à la Source, afin de se laisser toucher par la grâce, de se laisser convaincre par la puissance de la vérité.
Dieu de Jésus-Christ ne doit pas être confondu avec celui des philosophes et des savants ! Il est beaucoup plus que cela. Et ce n’est qu’avec le Cœur – qui ne se réduit pas au siège des sentiments, mais qui concentre tout ce qui fait de nous des créatures douées de raison, comme aussi d’émotions, comme aussi de religion (sensus divinitatis selon Calvin) – qu’il est possible de le connaître :
« C’est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point : on le sait en mille choses. » !
Blaise Pascal, Les Pensées
De la théologie réformée se dégage avant tout une certaine vision de Dieu et du rapport de l’homme avec Dieu, et c’est de cette réalité-là que dépend tout le reste.
Le témoignage intérieur du Saint Esprit convainc l’âme croyante de la souveraineté de Dieu et de la nécessité de sa révélation dans la Bible afin d’avoir de celui-ci une droite connaissance et afin de pouvoir l’aimer véritablement. On ne peut aimer que ce que l’on connaît… L’agnosticisme sous-jacent des théologies modernes a quelque chose de profondément frustrant. Il n’est pas étonnant que les églises libérales se vident… La foi appelle la foi. Mais là où le doute devient institutionnalisé – sous prétexte de rigueur scientifique -, on finit par sombrer dans l’incrédulité la plus crasse, le doute systématique.
Or « sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu ! » (Hébreux 11.6)
La foi-confiance (fides quae creditur) que l’on doit placer dans le Seigneur repose sur la fiabilité de la révélation de Dieu dans la Sainte Écriture, et donc sur la foi-croyance (fides qua creditur).
Il faut bien donc consacrer toute son énergie à montrer que cette Foi-là n’a rien perdu de sa pertinence et de son actualité par-delà les siècles, et qu’elle est donc la Foi véritable.
Telle est la tâche de la théologie réformée selon la Parole de Dieu.
Pasteur Vincent Bru, 20/11/2023
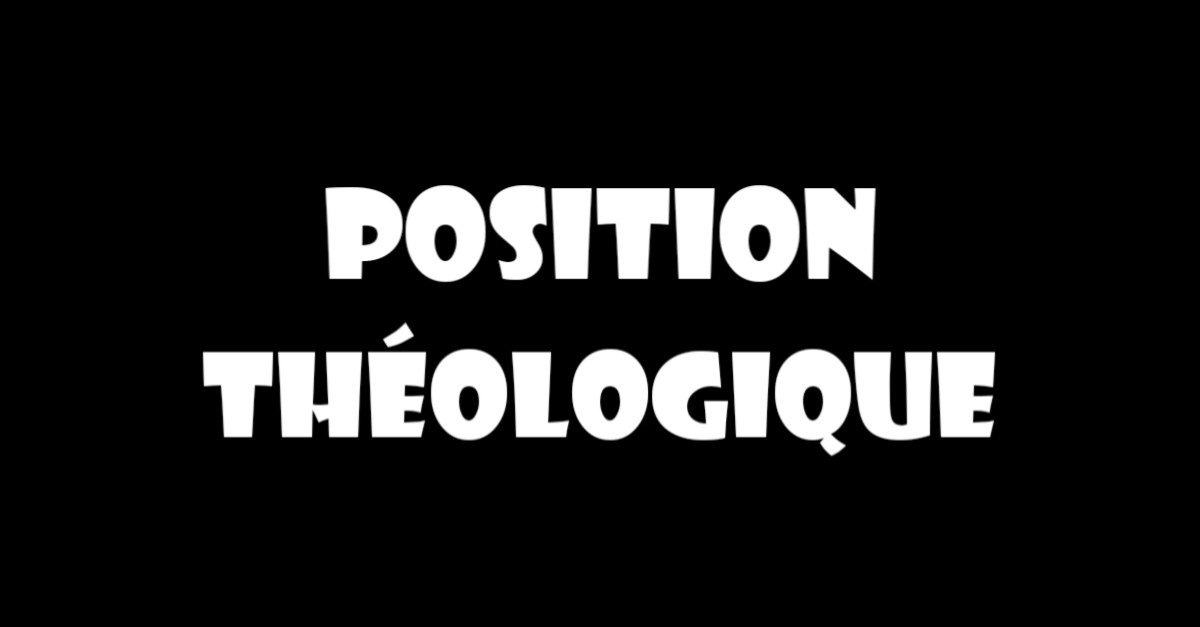
Laisser un commentaire