On retrouve chez Calvin ces trois autorités, interdépendantes et distinctes :
- celle de l’Église,
- celle des Écritures,
- celle du Saint-Esprit.
S’opposant au catholicisme « où toute certitude est ôtée à la Parole de Dieu » et où, finalement, l’on dépend de l’autorité des hommes, le réformateur est bien obligé cependant de faire cet aveu :
« Je confesse bien qu’il faut s’adresser l’Église pour avoir la pure doctrine, pour ce que Dieu lui en a donné l’administration. »
Commentaire sur Éphésiens 4.14
Thèse essentiellement catholique, semble-t-il : c’est l’Église qui est juge de la doctrine, c’est l’Église qui la définit, c’est l’Église qui interprète l’Écriture.
Oui, mais l’adhésion individuelle est, elle aussi, nécessaire et, en dernière analyse, c’est le Saint-Esprit parlant à la conscience du fidèle qui prononce (témoignage intérieur du Saint-Esprit).
En effet, pourquoi Calvin, reconnaissant qu’il faut s’adresser à l’Église pour avoir la pure doctrine, s’oppose-t-il au catholicisme, dont il semble adopter la thèse fondamentale ? C’est, nous dira-t-il, parce que « sous couleur du titre d’Église, les Papistes ensevelissent la doctrine » (Id.).
Bien ! Mais comment le sait-il ? C’est qu’il a lu lui même, avec son bon sens et ce qu’il affirme être l’illumination intérieure du Saint-Esprit, les livres de l’Écriture.
Et alors, ou bien il identifie son jugement avec celui de l’Église, et c’est lui, Calvin, qui est l’Église, et nous avons un pape, ou bien chacun est appelé à examiner lui-même librement, comme l’a fait Calvin, si la doctrine « administrée » par l’Église est bien conforme à celle qui se retrouve dans l’Écriture.
Mais – et c’est là que nous voulons en venir – ce jugement individuel n’est pas absolument libre, indépendant, subjectif. C’est un fait psychologique, sinon dogmatique, qu’il est influencé par tout le poids de la tradition, par toute l’autorité reconnue à l’Église, par le sens évident de l’Écriture et l’objectivité de la doctrine qui s’y trouve formulée.
Ce n’est en fait que rarement, à certains tournants de l’histoire, que le sens individuel, soulevé par une véritable illumination intérieure, doit faire front et s’opposer à l’autorité de la tradition et de l’Église au nom de l’Écriture.
Encore n’est-ce que pour un temps, la Réforme l’a bien montré ; bientôt se reconstitue l’autorité d’une Église, sinon de l’Église.
Le plus souvent, ces trois moments sont inséparables : autorité de l’Église, autorité de l’Écriture, autorité de la raison et de la conscience éclairée par le Saint-Esprit ; ces trois autorités se compénètrent et, en quelque sorte, fusionnent. On peut accentuer et souligner tel ou tel élément de la synthèse, mais on est bien obligé de reconnaître qu’il y a en fait une synthèse et nous croyons que le catholicisme lui-même n’échappe pas à cette nécessité.
Jean-Daniel Benoît, in Réflexions sur le protestantisme libéral au XIXe siècle. A propos d’un livre récent / Ernest Rochat, Le Développement de la théologie protestante française au XIXs siècle. Genève, Georg, 1942. [page 142, note 9]
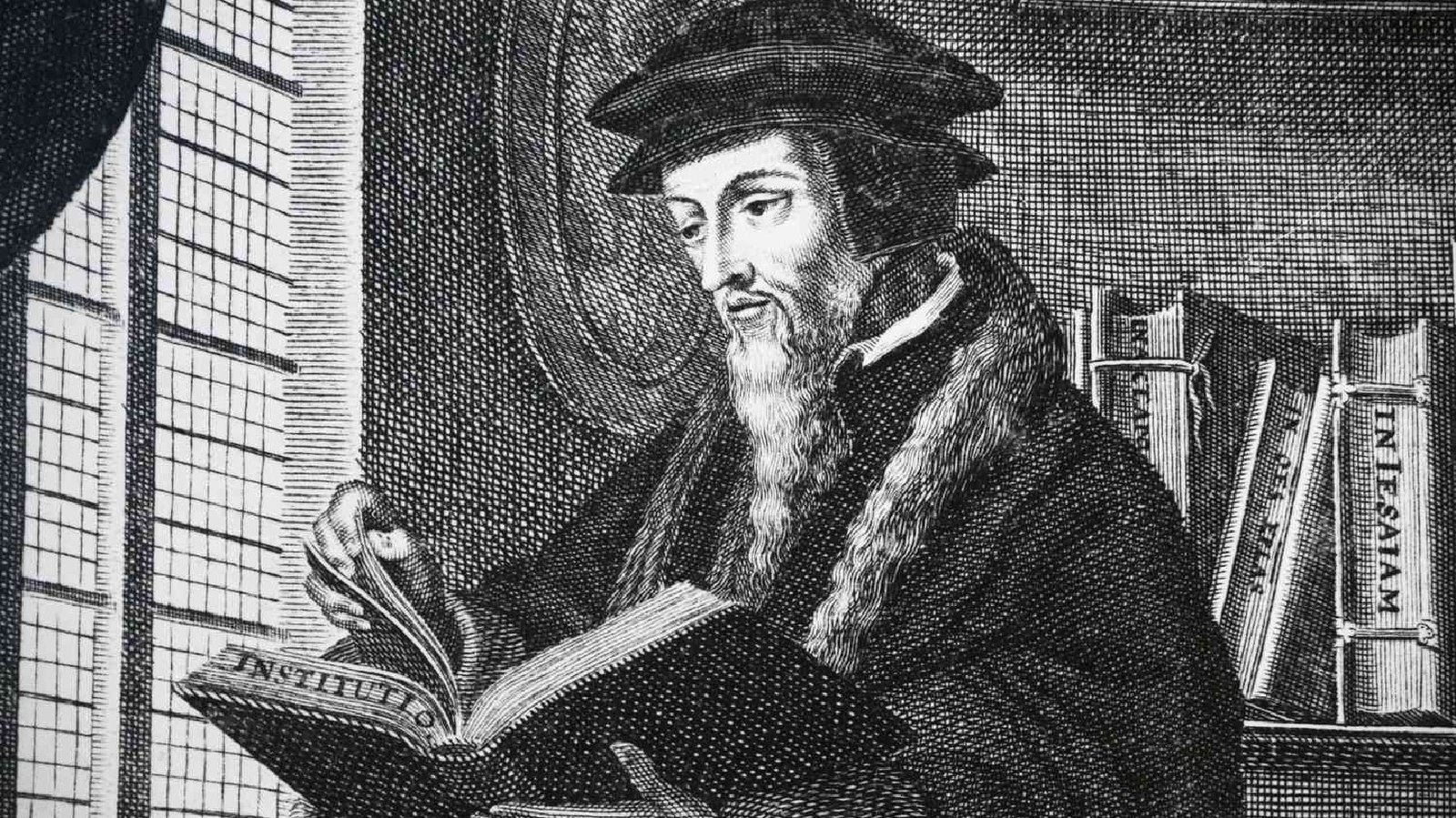
Laisser un commentaire