« Les mythes que nous tissons, même s’ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière, cette vérité éternelle qui est avec Dieu. »
J. R. R. Tolkien
L’écrivain catholique anglais, John Ronald Reuel Tolkien, auteur de la merveilleuse saga du Seigneur des anneaux, grand ami de l’écrivain protestant C. S. Lewis, auteur des chroniques de Narnia.
Biographie [wiki]
John Ronald Reuel Tolkien, plus connu sous la forme J. R. R. Tolkien est un écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d’université britannique né le 3 janvier 1892 à Bloemfontein (État libre d’Orange) et mort le 2 septembre 1973 à Bournemouth (Royaume-Uni).
Ses deux romans les plus connus, Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, prennent place dans l’univers de fiction de la Terre du Milieu dont il développe la géographie, les peuples, l’histoire et les langues durant la majeure partie de sa vie.
Après des études à Birmingham et à Oxford et l’expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale, John Ronald Reuel Tolkien devient professeur assistant (reader) de langue anglaise à l’université de Leeds en 1920, puis professeur de vieil anglais à l’université d’Oxford en 1925, et professeur de langue et de littérature anglaises en 1945, toujours à Oxford. Il prend sa retraite en 1959. Durant sa carrière universitaire, il défend l’apprentissage des langues, surtout germaniques, et bouleverse l’étude du poème anglo-saxon Beowulf avec sa conférence Beowulf : Les Monstres et les Critiques (1936). Son essai Du conte de fées (1939) est également considéré comme un texte crucial dans l’étude du conte merveilleux comme genre littéraire, et de la fantasy.
Tolkien commence à écrire (principalement des poèmes) pour son plaisir dans les années 1910, élaborant une forme de « mythologie » autour d’une langue construite. L’univers ainsi créé, la Terre du Milieu, prend forme au fil des réécritures et compositions. Son ami C. S. Lewis l’encourage dans cette voie, de même que les autres membres de leur cercle littéraire informel, les Inklings. En 1937, la publication du Hobbit fait de Tolkien un auteur pour enfants estimé. Sa suite longtemps attendue, Le Seigneur des anneaux, est d’une tonalité plus sombre. Elle paraît en 1954-1955 et devient un véritable phénomène de société dans les années 1960, notamment sur les campus américains. Tolkien travaille sur sa « mythologie » jusqu’à sa mort, mais ne parvient pas à donner de forme achevée au Silmarillion. Ce recueil de légendes des premiers âges de la Terre du Milieu est finalement mis en forme et publié à titre posthume en 1977 par son fils et exécuteur littéraire Christopher Tolkien, assisté de Guy Gavriel Kay. Au cours des décennies qui suivent, son fils publie régulièrement des textes inédits de son père.
De nombreux auteurs ont publié des romans de fantasy avant Tolkien, depuis William Morris et George MacDonald au XIXe siècle, mais le succès majeur remporté par Le Seigneur des anneaux au moment de sa publication en poche aux États-Unis (au milieu des années 1960) est, pour une large part, à l’origine d’une renaissance populaire du genre. Tolkien est ainsi souvent considéré comme l’un des « pères » de la fantasy moderne. Son œuvre a eu une influence majeure sur les auteurs ultérieurs de ce genre, en particulier par la rigueur avec laquelle il a construit son monde secondaire.
Voir sur cet écrivain catholique original :
- Tolkien et Lewis, amis et témoins ensemble, par Yannick IMBERT1
- Empreintes bibliques chez Tolkien, par Michaël Devaux, agrégé, docteur en philosophie
- J. R. R. Tolkien l’antimoderne, par Joanny Moulin
- Tolkien : « Le Seigneur des anneaux » est-il une œuvre catholique ?, par Louis Fraysse, journaliste à Réforme.
- Tolkien était un rêveur catholique écolo-conservateur, par Philippe Verdin
- Tolkien et la religion, par Leo Carruthers
- Le christianisme de Tolkien est-il présent dans ses œuvres ?, par Javier Segura
Un site pour les fans :
Bienvenue sur le site de Tolkiendil, Association Loi 1901 pour la promotion de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, auteur britannique du vingtième siècle, devenu une référence du genre imaginaire avec notamment Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Le Silmarillion.
Quelques citations (auteurs mentionnés ci-dessus) :
Le Seigneur des Anneaux est une « œuvre fondamentalement catholique », disait son auteur, J. R. R. Tolkien, dans une lettre à son ami R. Murray en 1953. Quel est ce fondement ? S’agirait-il de la Bible ? L’œuvre de Tolkien reprend-elle, emprunte-t-elle directement des citations à la Bible ou bien est-elle davantage empreinte d’une atmosphère biblique plus diffuse ? (…)
Tolkien collabora à la version anglaise de La Bible de Jérusalem. (…)
En somme, Tolkien emprunte ici, et laisse une empreinte plus large là, mais il n’impose surtout pas de lecture allégorique chrétienne avec des correspondances terme à terme (ce qui est le cas de C.S. Lewis dans Narnia où le lion Aslan est le Christ par exemple). La Bible est donc bien présente, mais passe dans ses œuvres comme en fraude, soustraite aux regards non avertis.
Michaël Devaux
D’un point de vue littéraire, l’œuvre de Tolkien opère une critique de la modernité. Mieux, Tolkien est un antimoderne. Cela s’entend au sens où Compagnon a défini ce type d’homme de lettres, dont il distingue six figures qui trouvent à l’évidence leur reflet chez Tolkien : « Contre-révolution, anti-Lumières, pessimisme, péché originel, sublime, vitupération » (Compagnon 18) (…) Tolkien et ses amis furent aussi antimodernistes. On en tiendra pour preuve l’aversion que C. S. Lewis eut d’abord pour T. S. Eliot, qui fut pourtant, dit Compagnon, « le champion du modernisme réactionnaire » (Compagnon 371) (…) Enfin, dans Les Anti-Lumières, Sternhell distingue dans ce mouvement intellectuel général de révolte contre les Lumières, auquel Tolkien appartient à bien des égards, « non pas une contre-modernité, mais une autre modernité ».
Joanny Moulin
Vous écrivez que Tolkien « veut nous faire prendre conscience d’un certain nombre de phénomènes qui se manifestent autour de nous, d’un certain nombre de sentiments qui s’emparent de nous » : que cherche-t-il à nous montrer ?
Il cherche à nous faire découvrir avec un étonnement admiratif nos aspirations à la beauté, au bien, au juste. Il cherche à réveiller nos élans chevaleresques. Il cherche à nous suggérer que, même humbles et petits, nous pouvons… sauver le monde ! Il veut également nous faire découvrir le monde merveilleux qui peut naître dans notre imagination grâce aux suggestions de son univers fabuleux. Il veut nous faire prendre conscience que la nature et la poésie nous en apprennent plus sur nous-mêmes et sur la vérité de notre destinée que le monde de l’industrie et du profit. C’est un rêveur catholique sous la forme écolo-conservateur…Dans Le Seigneur des anneaux, dites-vous, les femmes sont un antidote au mal, et le monde est sauvé par les petits : racontez-nous cela…
Philippe Verdin
J’ai envie de vous renvoyer plutôt à la lecture de mon livre ! Mais il est vrai que si les femmes semblent jouer un rôle secondaire dans l’épopée, leurs actions sont rares mais déterminantes. C’est comme dans l’Évangile ! Elles sont la présence qui réconforte, qui rend l’espoir, qui encourage. Elles résistent mieux à l’attraction de l’anneau parce qu’elles se battent pour la vie. Quant aux petits, ils donnent peut-être la plus belle leçon du Seigneur des anneaux : ils vivent les béatitudes, ils sont prêts à tout risquer pour sauver la terre du Milieu, ou plus prosaïquement pour aider leurs amis. Ce sont les femmes et les petits qui vont vaincre Sauron, le serviteur du mal.
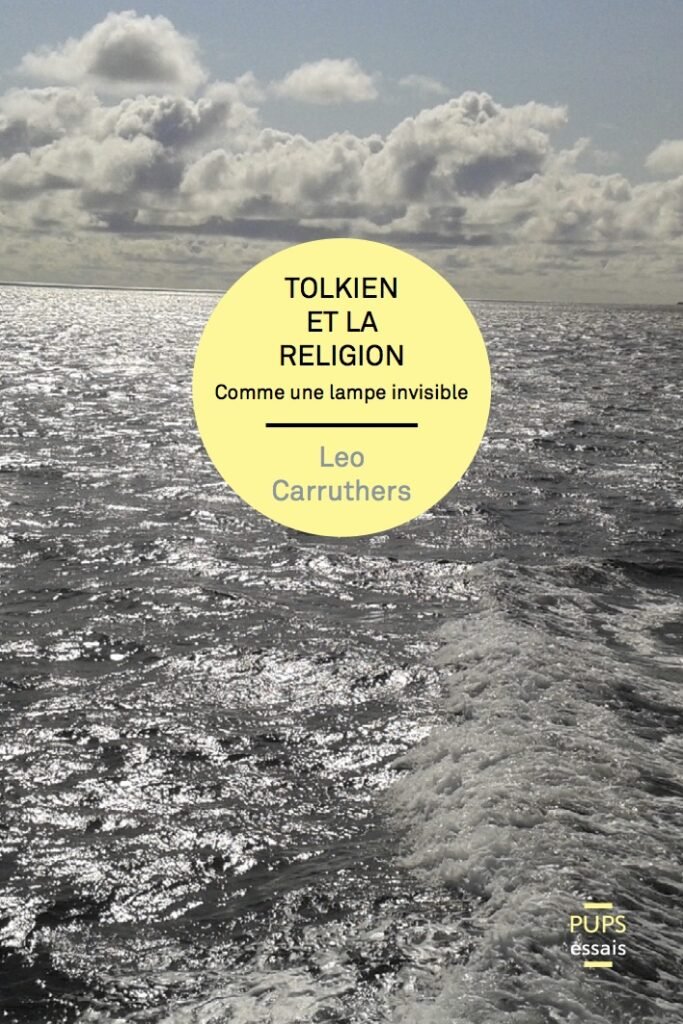
Peut-on qualifier Tolkien d’« auteur catholique » ? Ses romans véhiculent-ils une spiritualité définie ? Si le mythographe écarte le terme Dieu, et toute autre allusion à la religion, nombre de lecteurs sentent dans son œuvre la présence d’une « sorte de foi, comme une lampe invisible ».
La vie et l’œuvre de Tolkien, examinées dans la perspective religieuse, sont au cœur des deux parties de ce volume. Sa conversion au catholicisme est située dans le contexte historique du 19e siècle, qui affecte les catholiques et les protestants anglais. Tolkien restera toute sa vie un fidèle pieux et pratiquant ; mais, plutôt conservateur, il aura du mal à intégrer l’aggiornamento de l’Église suite à Vatican II. Il joue un rôle clé dans les Inklings, groupe d’intellectuels d’Oxford, animé par son meilleur ami, C.S. Lewis, universitaire connu pour ses livres de théologie populaire. Enfin, Tolkien le créatif a puisé son inspiration en grande partie dans les textes du Moyen Âge, chrétiens, païens ou mixtes, qu’il connaît professionnellement, dont plusieurs sont présentés ici.
La seconde partie du livre explore la mythologie de Tolkien, non seulement les deux romans publiés de son vivant (Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux), mais aussi l’ensemble de légendes, sur lequel il travaillait incessamment, sans pouvoir l’achever de manière satisfaisante. Les récits les plus développés seront publiés plus tard par son fils Christopher : Le Silmarillion et L’Histoire de la Terre du Milieu. Plus accentués vers la fin de sa vie, les thèmes du mythe, de la religion et de la spiritualité y sont présents à divers degrés.
Vidéos
- Yannick Imbert est professeur d’apologétique et directeur de Licence à la Faculté Jean Calvin (Aix-en-Provence). Expert de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, sur lequel il a rédigé sa thèse (Westminster Theological Seminary), il travaille les thèmes d’imagination et de fantastique. Il a aussi travaillé le rapport entre entre foi et société lors de ses études à l’Institut de Sciences Politiques. Il est aussi président des Éditions Kérygma, ainsi que membre de la Commission Théologique du Conseil National des évangéliques de France (CNEF). ↩︎

Laisser un commentaire