Vincent Bru, 4 décembre 20261
L’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par une opération militaire américaine, assumée et revendiquée par Donald Trump, marque un tournant symbolique et politique majeur. Non parce que l’histoire n’aurait jamais connu d’interventions de ce type, mais parce que, cette fois, elles sont revendiquées sans fard, sans habillage juridique multilatéral, et présentées comme une application normale d’une doctrine de puissance explicitement assumée.
Le discours de Trump est limpide : sécurité nationale, lutte contre une narco-dictature, défense des intérêts vitaux américains dans l’hémisphère occidental. Le droit international n’est pas nié frontalement ; il est relégué. Ce qui compte, c’est l’efficacité stratégique et la protection des siens. Le message adressé au monde est brutal : l’ère du légalisme incantatoire est terminée, la force est de retour comme principe structurant des relations internationales.
Les réactions internationales ont été immédiates et profondément clivantes. Certains se sont réjouis de la chute d’un régime autoritaire tenu pour responsable de la ruine économique du Venezuela et de l’exil de millions de ses habitants. D’autres ont dénoncé une violation grave de la souveraineté et du droit international, redoutant un précédent ouvrant la voie à un monde sans règles. Entre ces deux pôles, une ligne plus nuancée s’est exprimée, notamment en Europe, avec Emmanuel Macron, qui a rappelé à la fois l’illégitimité du régime Maduro et le caractère problématique de la méthode employée, tout en appelant à une transition conduite par le peuple vénézuélien.
Cette diversité de réactions montre que le débat ne porte plus seulement sur Maduro, ni même sur le Venezuela. Il révèle une crise plus profonde : crise du droit international, crise de la souveraineté, crise de notre capacité morale à penser un monde redevenu tragique. C’est dans ce contexte que s’inscrit la synthèse qui suit : une tentative de tenir ensemble le réalisme et la retenue, la nécessité de la force et l’exigence du droit, la lucidité historique et le discernement biblique, dans une perspective réformée et non naïve.
Cartographie synthétique des prises de position
Les réactions à l’arrestation de Maduro peuvent être regroupées en quatre grandes familles intellectuelles et politiques, qui traversent largement les clivages traditionnels gauche/droite.
1. Les opposants de principe : le légalisme souverainiste
Ce courant condamne sans ambiguïté l’intervention américaine, indépendamment de la nature du régime Maduro.
Leur principe cardinal est l’inviolabilité absolue de la souveraineté des États et le respect strict du droit international.
France
- Jean-Luc Mélenchon
La France insoumise – gauche radicale
Anti-impérialisme, condamnation systématique des interventions occidentales.
International
- Luiz Inácio Lula da Silva
Gauche latino-américaine institutionnelle
Défense de la souveraineté et du multilatéralisme. - Noam Chomsky
Gauche anti-impérialiste
Refus de principe de l’usage unilatéral de la force.
Logique dominante :
– toute violation de souveraineté crée un précédent mortel ;
– le droit, même imparfait, vaut mieux que la loi du plus fort ;
– changer de régime par la force est toujours illégitime.
Limite majeure :
– ce légalisme tend à protéger les régimes en place plus efficacement que les peuples qu’ils oppriment ;
– il peine à répondre aux situations où le droit est structurellement impuissant.
2. Les nuancés : condamnation juridique, lucidité stratégique
Cette position reconnaît pleinement le caractère tyrannique et destructeur du régime Maduro, tout en refusant de valider la méthode américaine.
France /Europe
- Emmanuel Macron
Centre libéral – européisme
Illégitimité du régime reconnue, inquiétude sur la méthode, priorité à la transition. - Pedro Sánchez
Social-démocratie
Condamnation juridique, souci de stabilité régionale. - Olaf Scholz
Sociaux-démocrates allemands
Légalisme strict, prudence stratégique.
Intellectuels
- Michael Walzer
Libéralisme moral – théorie de la guerre juste
Dilemme tragique, attention aux civils et à l’après. - Samuel Moyn
Historien critique des droits de l’homme
Constat d’épuisement du cadre juridique sans célébration de la force.
Logique dominante :
– la chute d’un dictateur n’est pas un mal en soi ;
– la violation du droit international reste grave et dangereuse ;
– l’essentiel est l’« après » : restitution rapide de la parole au peuple, absence de tutelle durable.
C’est dans cette catégorie que se situent la plupart des responsables européens, dont Emmanuel Macron.
Limite majeure :
– difficulté à trancher : cette position décrit finement le dilemme, mais peine souvent à assumer une ligne d’action claire dans un monde brutal.
3. Les favorables conditionnels : réalisme espérant un bien possible
Ce courant soutient ou accepte l’intervention en pariant sur ses effets bénéfiques, sans pour autant nier les risques.
France
- Philippe de Villiers
Souverainisme civilisationnel
Réalisme historique, méfiance envers le juridisme, prudence sur l’après. - Sarah Knafo
Droite nationale /sécuritaire
Légitime défense élargie face aux narco-États.
International
- Giorgia Meloni
Droite conservatrice
Soutien pragmatique, priorité à la stabilité. - Javier Milei
Libertarien /anti-socialiste
Chute d’un régime de gauche vue comme un bien.
Logique dominante :
– un tyran de moins est déjà un bien ;
– le droit international a échoué au Venezuela ;
– l’action doit être jugée à ses fruits, notamment la possibilité d’une transition réelle.
Limite majeure :
– tendance à sous-estimer les risques de chaos, de prédation ou de normalisation de la force ;
– confiance parfois excessive dans la capacité morale des puissances intervenantes.
4. Les réalistes assumés : la force comme nouvelle norme
Ici, le débat juridique est considéré comme secondaire, voire obsolète.
La force est vue comme le véritable langage du monde contemporain.
France
- Éric Zemmour
Droite nationale-réaliste
Guerre non déclarée (drogue, immigration), primat de la force.
États-Unis /monde anglo-saxon
- Donald Trump
America First – réalisme dur
Doctrine assumée, intérêts vitaux avant le droit. - Robert Kagan
Néoconservatisme
Le monde revient aux empires ; la force occidentale comme stabilisateur. - Peter Zeihan
Réalisme géo-économique
Remodelage inévitable des États faibles.
Logique dominante :
– la géopolitique n’a jamais été morale ;
– la souveraineté réelle se mesure à la puissance ;
– l’inaction est plus dangereuse que l’action.
Cette ligne est souvent articulée autour d’un discours de survie civilisationnelle et de sécurité.
Limite majeure :
– risque de banalisation de la violence ;
– affaiblissement durable de toute norme commune ;
– glissement possible vers une loi du plus fort sans frein.
Ces quatre familles ne sont pas simplement des opinions concurrentes : elles traduisent des visions du monde incompatibles sur la nature de l’histoire, du pouvoir et du mal. La synthèse organique qui suit cherche à tenir ensemble ce que beaucoup opposent : la nécessité du droit sans l’idolâtrer, la réalité de la force sans la sacraliser, et la conscience biblique d’un monde tragique où Dieu gouverne sans jamais justifier l’orgueil des puissants.
C’est dans cet espace étroit, inconfortable mais fidèle au réel, que peut se déployer une lecture chrétienne et réformée de notre temps.
Point de départ : sortir des faux dilemmes
Le débat qui s’est cristallisé autour de l’arrestation de Nicolás Maduro est révélateur d’un travers intellectuel ancien, mais aujourd’hui aggravé : l’enfermement dans un faux dilemme moral opposant, d’un côté, le droit international, et de l’autre, la force brute. Comme si l’on devait nécessairement choisir entre une pureté juridique sans prise sur le réel et un cynisme brutal affranchi de toute norme.
Or cette opposition est historiquement, philosophiquement et bibliquement intenable.
La géopolitique n’a jamais été le lieu de la pureté morale. Elle est, depuis toujours, le lieu du tragique, du compromis, de la contrainte et parfois du moindre mal. Le droit n’y a jamais existé sans puissance pour le soutenir, et la puissance n’y a jamais été durable sans un minimum de justification morale, fût-elle imparfaite, implicite ou instrumentalisée.
Déjà, Thucydide, dans le Dialogue des Méliens, mettait en scène cette vérité brutale :
« Les forts font ce qu’ils peuvent, les faibles subissent ce qu’ils doivent. »
Mais Thucydide ne célébrait pas cette loi : il la constatait comme une tragédie humaine, non comme une norme morale. Toute la tradition réaliste sérieuse s’inscrit dans cette lucidité, non dans une apologie de la force.
Au XXᵉ siècle, Raymond Aron a rappelé avec force que la politique internationale ne pouvait être jugée selon les mêmes critères que l’éthique individuelle :
« La politique internationale est le domaine par excellence de l’incertitude et du tragique. Vouloir y appliquer une morale de la pureté conduit soit à l’impuissance, soit à l’hypocrisie. »
(Paix et guerre entre les nations)
Aron ne justifie pas tout ; il refuse l’illusion. Il montre que le droit international n’est pas une loi transcendante s’imposant aux États comme la loi morale à la conscience individuelle, mais une construction fragile, dépendante du rapport de forces et du consentement des puissances.
Dans la même veine, Hans Morgenthau, fondateur du réalisme classique, écrivait :
« Le réalisme politique refuse d’identifier les aspirations morales d’une nation avec les lois morales qui gouvernent l’univers. »
(Politics Among Nations)
Cela ne signifie pas que la morale n’a pas sa place, mais qu’elle ne peut être appliquée sans discernement au niveau des relations entre puissances, sous peine de produire des effets contraires à ceux recherchés.
Le choc ressenti aujourd’hui en Europe face à l’acte américain révèle moins la brutalité intrinsèque de l’événement que notre perte de catégories pour penser le tragique. Depuis plusieurs décennies, l’Europe a intériorisé l’idée que le droit international constituait non seulement un cadre régulateur, mais une sorte de rempart quasi salvateur contre le mal politique. Or l’histoire biblique, comme l’histoire tout court, ne valide jamais cette espérance.
Dans la vision biblique, le mal ne disparaît jamais par décret juridique. Il est contenu, freiné, parfois déplacé, mais jamais éradiqué par la loi humaine. La loi a une fonction réelle, mais limitée. Elle est un frein, non un rédempteur.
C’est précisément ce que souligne l’apôtre Paul lorsqu’il distingue la Loi et la Justice. La loi révèle, limite, ordonne, mais elle ne transforme pas le cœur. Transposé au plan politique, cela signifie que le droit international peut limiter certains excès, mais qu’il ne peut ni empêcher l’émergence de tyrannies, ni garantir leur chute.
La réaction européenne actuelle trahit ainsi une difficulté plus profonde : nous avons confondu normativité et réalité, légalité et justice, procédure et finalité. Or, comme le rappelait déjà Augustin d’Hippone,
« Sans justice, que sont les royaumes sinon de grandes bandes de brigands ? »
(La Cité de Dieu, IV, 4)
Mais Augustin ajoute aussitôt que cette justice n’est jamais pleinement réalisée dans l’histoire. Elle est toujours partielle, fragile, contestée. C’est pourquoi la politique reste un art tragique, jamais un exercice de sainteté.
Ainsi, poser le débat en termes binaires — droit ou force — revient à refuser d’affronter la condition réelle des nations dans un monde déchu. La question n’est pas de choisir entre la loi et la puissance, mais de discerner comment la puissance est exercée, dans quel but, avec quelles limites, et sous quelle conscience morale.
C’est à ce niveau, et seulement à ce niveau, que peut s’ouvrir une réflexion chrétienne, réformée et responsable, qui refuse à la fois le juridisme naïf et le réalisme cynique.
Le droit de la guerre et la guerre juste : intention, pas seulement procédure
La tradition du jus ad bellum, telle qu’elle s’est élaborée chez Augustin d’Hippone puis systématisée par Thomas d’Aquin, ne commence jamais par le droit positif. Elle ne part ni des procédures, ni des cadres juridiques existants, mais d’une question plus radicale, plus inconfortable, et profondément morale : dans quel but la force est-elle employée ?
Autrement dit, la question première n’est pas : « Est-ce légal ? »
mais : « À quoi cela tend-il ? »
La légalité est importante, mais elle n’est jamais première. Elle est un signe possible de justice, non sa garantie.
Augustin pose d’emblée le cadre. Dans La Cité de Dieu, il refuse toute sacralisation de la guerre, y compris lorsqu’elle est menée par une autorité légitime :
« Les guerres justes sont celles qui vengent des injustices, lorsque la nation ou la cité contre laquelle on fait la guerre a négligé de punir les fautes commises par les siens ou de restituer ce qui a été injustement enlevé. »
(La Cité de Dieu, XIX, 7)
Mais cette définition est immédiatement encadrée par une exigence plus haute encore. Augustin précise ailleurs :
« Le désir de nuire, la cruauté dans la vengeance, l’ardeur implacable et sauvage, la fureur dans la guerre, la soif de domination, voilà ce qui est justement condamné dans les guerres. »
(La Cité de Dieu, XIX, 7)
Ainsi, pour Augustin, la justice d’une guerre ne se mesure pas seulement à sa cause, mais à l’intention morale qui l’anime. Une guerre peut avoir une cause objectivement juste et être menée dans un esprit profondément injuste. Inversement, une action violente peut être moralement tolérée si elle vise réellement à restaurer une paix plus ordonnée, et non à satisfaire la domination ou la vengeance.
Thomas d’Aquin reprend et structure cette tradition dans la Somme théologique (IIa-IIae, q. 40, art. 1). Il énonce trois critères devenus classiques :
- Autorité légitime
« Il faut, premièrement, que la guerre soit déclarée par l’autorité du souverain. »
L’usage de la force ne peut relever d’initiatives privées, de bandes armées ou d’intérêts particuliers. Il engage une responsabilité publique.
- Cause juste
« Il faut une cause juste, c’est-à-dire que ceux qu’on attaque aient mérité d’être attaqués en raison d’une faute. »
La guerre n’est jamais préventive au sens d’une peur vague ; elle répond à une injustice réelle et grave.
- Intention droite
« Il faut enfin que l’intention des combattants soit droite, visant la promotion du bien ou l’évitement du mal. »
C’est ici que Thomas radicalise Augustin : une guerre peut être déclarée par une autorité légitime et pour une cause juste, mais devenir injuste si l’intention est corrompue.
Dans cette tradition, l’intention droite n’est pas une disposition psychologique privée, mais une orientation objective de l’action vers la paix. La paix n’est pas ici l’absence de conflit, mais ce que Augustin appelle tranquillitas ordinis — la tranquillité de l’ordre.
Appliqué au cas vénézuélien, ce cadre interdit immédiatement deux simplifications symétriques.
D’une part, il interdit de dire que la chute d’une narco-dictature serait en soi un mal. Un régime qui détruit son peuple, organise ou tolère la criminalité transnationale, provoque l’exode massif de millions de personnes et déstabilise ses voisins constitue une injustice grave. Mettre fin à une telle situation ne peut être qualifié automatiquement d’injuste.
D’autre part, ce cadre interdit tout autant de dire que toute action conduisant à cette chute serait automatiquement juste. La fin ne sanctifie jamais les moyens. Une cause juste ne dispense pas d’un examen moral rigoureux de l’autorité qui agit, de ses intentions réelles et de la finalité poursuivie.
C’est pourquoi il faut tenir ensemble deux affirmations sans les opposer :
– l’acte est juridiquement fautif au regard du droit international classique, qui interdit l’usage unilatéral de la force hors légitime défense immédiate ou mandat explicite ;
– l’acte n’est pas moralement neutre, car il met fin à un régime objectivement destructeur et criminel.
Ce paradoxe n’est pas une contradiction, mais l’expression même du tragique politique tel que le pense Augustin. La guerre juste, chez lui, n’est jamais « juste » au sens positif ou lumineux du terme. Elle est toujours un mal, parfois nécessaire pour empêcher un mal plus grand.
C’est pourquoi Augustin écrit encore :
« Même lorsqu’elles sont justes, les guerres sont menées avec tristesse par les bons, non avec joie. »
(Lettre 189)
Cette tristesse n’est pas un détail spirituel : elle est le signe que l’on n’a pas transformé la nécessité en vertu, ni la puissance en idole.
Dans cette perspective, le discernement chrétien ne consiste ni à absoudre automatiquement l’action au nom de ses résultats, ni à la condamner abstraitement au nom d’une légalité devenue impuissante. Il consiste à juger l’intention, la finalité, les limites, et les fruits, sans jamais oublier que, dans l’histoire humaine, le bien advient parfois par des chemins impurs, sans jamais devenir pur pour autant.
C’est cette sagesse tragique — ni cynique, ni naïve — que la tradition du jus ad bellum lègue encore à notre temps.
Les limites structurelles du droit international
Le choc provoqué par l’arrestation de Nicolás Maduro agit comme un révélateur. Non pas tant de la brutalité du monde — qui n’a jamais disparu — que de la fragilité intrinsèque du droit international tel qu’il fonctionne réellement. Trois faiblesses majeures apparaissent aujourd’hui avec une clarté presque pédagogique.
1. Un droit qui protège d’abord les États, non les peuples
Le droit international moderne est né dans un cadre westphalien : il vise avant tout à réguler les relations entre États souverains. Sa préoccupation première n’est pas la justice substantielle, mais la stabilité formelle.
Comme l’a montré Hans Kelsen, l’un des architectes du normativisme juridique international, le droit international est un système de normes dont la validité dépend de leur reconnaissance par les États eux-mêmes. Il ne juge pas les régimes selon leur justice morale, mais selon leur existence juridique.
Cette logique conduit à une conséquence problématique :
un régime peut être juridiquement protégé tout en étant moralement monstrueux.
Les peuples opprimés deviennent alors des variables secondaires. Tant que l’État existe, qu’il est reconnu, qu’il siège dans les institutions internationales, le droit fonctionne comme un bouclier de souveraineté, même lorsque cette souveraineté est retournée contre ceux qu’elle est censée protéger.
Déjà, Raymond Aron notait avec lucidité :
« Le droit international n’est pas un droit des peuples, mais un droit des États. Il régit les rapports de puissance, non la justice des régimes. »
(Paix et guerre entre les nations)
Cela ne rend pas ce droit illégitime, mais structurellement limité.
2. Un droit paralysé par les grandes puissances
La seconde faiblesse est plus visible encore : le droit international est dépendant de ceux qu’il est censé contraindre.
Le Conseil de sécurité de l’ONU, censé garantir la paix collective, est paralysé par le droit de veto des grandes puissances. Ce n’est pas un accident du système, mais sa condition de possibilité : sans ce veto, les puissances n’y auraient jamais consenti.
Comme le rappelait Hedley Bull :
« L’ordre international repose non sur l’égalité morale des États, mais sur un compromis instable entre les grandes puissances. »
(The Anarchical Society)
Lorsque ces puissances violent elles-mêmes les règles, il n’existe aucun mécanisme réel pour les contraindre. Le droit devient alors sélectif, appliqué aux faibles, négocié avec les forts, contourné par les dominants.
Ce constat n’est pas nouveau. Carl Schmitt — penseur controversé mais lucide sur ce point — écrivait déjà :
« Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. »
Dans les moments de crise majeure, ce ne sont pas les normes qui décident, mais ceux qui ont la capacité de suspendre leur application. Le droit international n’échappe pas à cette logique.
3. Un droit sans force coercitive propre
Enfin, le droit international souffre d’un handicap fondamental : il ne dispose pas de moyens de coercition autonomes.
Contrairement au droit interne, il n’existe ni police internationale effective, ni armée mondiale légitime, ni pouvoir exécutif capable d’imposer ses décisions sans le concours volontaire des États.
Comme l’écrivait Thomas Hobbes — bien avant l’ONU — :
« Les pactes sans l’épée ne sont que des mots. »
(Le Léviathan, chap. XVII)
Le droit international repose donc sur un pari fragile : la bonne volonté relative des États et la pression morale de l’opinion internationale. Lorsque ces deux leviers échouent, il ne reste souvent qu’un langage de protestation, non une solution opératoire.
C’est précisément ce qui se produit lorsque des régimes deviennent simultanément :
– tyranniques à l’intérieur,
– criminels à l’extérieur,
– et protégés par des alliances ou des vetos.
Dans ces cas, le droit international peut dénoncer, condamner, sanctionner marginalement — mais rarement transformer la situation.
Ni rejet, ni idolâtrie
Reconnaître ces limites ne conduit pas à jeter le droit international par-dessus bord. Ce serait une faute grave. Le droit demeure un frein réel, un langage commun minimal, un cadre qui limite certains excès et empêche la violence de devenir totalement arbitraire.
Mais l’erreur inverse serait de transformer ce droit en idole séculière, en croyant qu’il pourrait, par sa seule existence normative, contenir le mal politique.
La sagesse biblique et la tradition réaliste convergent ici : la loi est nécessaire, mais elle n’est jamais salvatrice. Elle ordonne, elle limite, elle avertit — elle ne rachète pas.
C’est pourquoi le discernement chrétien et réformé ne consiste ni à sacraliser le droit international comme ultime instance morale de l’histoire, ni à le mépriser comme simple hypocrisie des puissants. Il consiste à le resituer à sa juste place : un instrument fragile dans un monde déchu, utile mais insuffisant, précieux mais non absolu.
C’est seulement à partir de cette lucidité que peut s’ouvrir un jugement moral responsable sur les actes de force : non pour les justifier a priori, mais pour les évaluer sans illusion, sans naïveté, et sans abdication morale.
Réalisme tragique : l’histoire n’est pas morale, mais elle a une morale
La position de Philippe de Villiers est précieuse parce qu’elle refuse deux naïvetés symétriques qui dominent aujourd’hui le débat public.
La première consiste à croire que le droit suffit à contenir la violence du monde.
La seconde à croire que la force pourrait s’exercer sans conséquences morales, politiques ou historiques.
Ces deux illusions procèdent d’une même erreur : le refus de penser le tragique de l’histoire.
L’histoire humaine n’est pas morale au sens où elle ne se plie pas spontanément aux normes éthiques que nous formulons. Elle est traversée par la violence, l’injustice, la domination et l’échec. Mais elle n’est pas amorale pour autant. Elle juge, à long terme, les intentions, les excès, les renoncements et les lâchetés. Elle possède une morale immanente, lente, souvent cruelle, mais réelle.
C’est ce que Raymond Aron exprimait avec une lucidité constante :
« L’histoire n’est pas le tribunal de la conscience morale, mais elle est le tribunal des conséquences. »
(Paix et guerre entre les nations)
Aron ne justifie pas la force ; il rappelle que l’inaction n’est jamais neutre. Refuser d’agir au nom de la pureté morale peut produire des effets aussi destructeurs que l’action mal orientée. Le tragique naît précisément de cette alternative impossible : agir imparfaitement ou laisser faire un mal plus grand.
C’est pourquoi l’histoire oblige parfois à reconnaître que le mieux peut devenir l’ennemi du bien. Chercher la solution parfaite, juridiquement irréprochable et moralement pure, peut conduire à une paralysie qui abandonne les victimes réelles à leur sort. Cette sagesse tragique traverse toute la tradition politique réaliste, bien au-delà des clivages idéologiques.
Déjà, Max Weber distinguait l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité :
« Celui qui agit selon l’éthique de la conviction se sent responsable uniquement de la pureté de son intention ; celui qui agit selon l’éthique de la responsabilité répond des conséquences prévisibles de ses actes. »
(Le Savant et le Politique)
Weber ne prône pas le cynisme. Il avertit que la politique exercée sans responsabilité pour les conséquences devient une posture morale creuse, parfois criminelle par omission. À l’inverse, l’éthique de la responsabilité exige une charge morale plus lourde : accepter d’agir dans l’impur, tout en refusant de s’y complaire.
C’est ici que la formule souvent attribuée à Augustin prend tout son poids, même lorsqu’elle n’est pas citée textuellement : la guerre juste n’est jamais juste en elle-même. Elle est toujours une blessure infligée à l’ordre voulu par Dieu, parfois tolérée pour empêcher un désordre plus profond.
Augustin écrit ainsi :
« Ce n’est pas la paix que recherchent les méchants quand ils font la guerre, mais la guerre qu’ils font pour leur paix. »
(La Cité de Dieu, XIX)
Mais il ajoute ailleurs, avec une gravité décisive :
« Les bons font la guerre par nécessité, non par volonté. »
(Lettre 189)
Cette distinction est fondamentale. Le réalisme tragique chrétien ne célèbre jamais la force. Il ne s’en réjouit pas. Il la supporte comme une nécessité douloureuse, sous condition, avec crainte et tremblement.
C’est en ce sens que la position de Philippe de Villiers échappe au nihilisme. Elle ne dit pas : tout se vaut. Elle dit : tout a un prix. Et ce prix est toujours payé, tôt ou tard, soit par l’action, soit par l’inaction.
Refuser de « se salir les mains » peut parfois signifier laisser le mal prospérer intact, se consolider, s’institutionnaliser. L’histoire du XXᵉ siècle est tragiquement riche de ces moments où la pureté proclamée a servi de masque à l’abdication morale. Inversement, l’usage de la force sans retenue ni conscience engendre des monstres dont les générations suivantes héritent.
Le réalisme tragique suppose donc une discipline morale plus exigeante, non plus faible. Il oblige à répondre de trois choses :
– des intentions (pourquoi agir ?)
– des limites (jusqu’où ne pas aller ?)
– des effets (qu’avons-nous réellement produit ?)
C’est pourquoi ce réalisme est incompatible avec toute glorification de la puissance. Il refuse l’ivresse de la victoire comme la bonne conscience de l’inaction. Il reconnaît que l’histoire est un champ de responsabilités imparfaites, où l’on n’échappe jamais complètement à la faute, mais où l’on est toujours responsable de ce que l’on fait — et de ce que l’on laisse faire.
Dans cette perspective, le tragique n’est pas une excuse. Il est un appel à la vigilance, à l’humilité, et à une lucidité sans illusions. Une sagesse dure, inconfortable, mais profondément humaine — et profondément biblique.
Les risques d’un monde sans droit
Reconnaître les limites structurelles du droit international ne conduit pas mécaniquement à célébrer sa disparition. Bien au contraire. Il faut être lucide : la normalisation d’actions unilatérales de force, hors de tout cadre juridique commun, porte en elle des dangers majeurs, non seulement pour les faibles, mais à terme pour tous.
1. La banalisation des changements de régime par la force
Le premier risque est celui de la banalisation. Une fois admis qu’un État peut renverser un autre régime au nom de la sécurité, de la morale ou de l’efficacité, la barrière normative tombe. Ce qui était l’exception devient la méthode.
Or l’histoire montre que les exceptions répétées finissent toujours par devenir des règles implicites. Hannah Arendt notait déjà que la violence, lorsqu’elle cesse d’être exceptionnelle, devient un mode de gouvernement :
« La violence peut détruire le pouvoir ; elle est absolument incapable de le créer. »
(On Violence)
Un monde où les changements de régime deviennent routiniers par la force n’est pas un monde libéré des tyrans, mais un monde structurellement instable, où chaque gouvernement vit sous la menace permanente d’une intervention extérieure.
2. L’instrumentalisation morale a posteriori
Le second danger est plus subtil, mais tout aussi corrosif : la justification morale a posteriori.
Le raisonnement est bien connu :
le régime était tyrannique ; donc son renversement était juste ; donc l’action était légitime.
Ce glissement est intellectuellement dangereux. Il transforme le résultat en critère de justice et neutralise tout examen des intentions, des moyens et des effets secondaires. Comme l’a montré Michael Walzer, la justice d’une guerre ne peut jamais être déduite uniquement de la nature du régime combattu :
« Le fait que l’ennemi soit mauvais ne rend pas automatiquement juste tout ce que nous faisons contre lui. »
(Just and Unjust Wars)
Lorsque la morale devient un simple habillage narratif a posteriori, elle cesse d’être une norme contraignante et devient un outil de légitimation opportuniste.
3. La justification symétrique par les puissances rivales
Le troisième risque est celui de la symétrie. Une norme abandonnée par l’un devient immédiatement disponible pour tous.
Si une puissance justifie une intervention unilatérale au nom de la sécurité, de la morale ou de la lutte contre le mal, toutes les autres peuvent invoquer exactement les mêmes arguments. Le vocabulaire est interchangeable ; seules changent les cibles.
C’est ce que Raymond Aron appelait la logique des précédents :
« Dans un monde sans règles effectives, chaque acte devient un précédent pour les autres. »
(Paix et guerre entre les nations)
Ainsi, ce qui est présenté comme une action exceptionnelle peut devenir une autorisation implicite pour la guerre permanente, chacun se proclamant juge de la justice de sa propre cause.
4. L’effacement progressif de toute norme commune
Enfin, le risque ultime est l’effacement progressif de toute norme partagée. Le droit international, même imparfait, fournit encore un langage commun, un cadre minimal de justification, un espace de contestation et de retenue.
Sans ce cadre, il ne reste plus que le rapport de force brut. Or, comme le rappelait Thomas Hobbes :
« Là où il n’y a pas de loi commune, il n’y a ni injustice ni justice, mais seulement la force. »
(Le Léviathan)
Un monde sans droit international n’est donc pas un monde plus juste. C’est un monde plus instable, où seuls survivent ceux qui sont déjà forts, et où les faibles deviennent des zones grises permanentes, objets de rivalités plutôt que sujets de droit.
Force nécessaire, mais jamais autojustificatrice
La tradition réaliste sérieuse — philosophique, politique et théologique — converge ici : la force peut être nécessaire, parfois tragiquement indispensable pour contenir un mal plus grand. Mais elle ne doit jamais devenir autojustificatrice.
Dès l’instant où la puissance se donne elle-même sa légitimité, elle bascule dans ce que Augustin d’Hippone dénonçait déjà :
« En l’absence de justice, les royaumes ne sont que de grandes bandes de brigands. »
(La Cité de Dieu, IV, 4)
Le droit international, malgré ses failles, demeure un frein, une mémoire normative, une résistance imparfaite à la dérive de la force. Le mépriser serait ouvrir la voie à un monde de prédation généralisée. L’idolâtrer serait se condamner à l’impuissance morale.
La sagesse tragique consiste à tenir ensemble ces deux vérités inconfortables :
– parfois, la force est nécessaire ;
– toujours, elle doit être jugée, limitée, contestée.
C’est dans cette tension — et non dans le confort des absolus — que peut encore subsister une responsabilité politique digne de ce nom.
Théologie de l’alliance : nations, limites et Babel
La théologie de l’alliance offre une clé de lecture décisive pour penser le rôle des nations dans l’histoire et relativiser toute prétention humaine à un ordre politique universel, moralement pur et définitivement stabilisé. Contrairement à certaines lectures modernes — qu’elles soient progressistes ou technocratiques — l’Écriture ne dissout jamais les nations dans une humanité indifférenciée. Elle les reconnaît, les maintient et les juge.
Dès les premières pages de la Bible, les nations apparaissent non comme une anomalie à corriger, mais comme une réalité structurante de l’histoire humaine. Après la Chute, Dieu ne supprime pas les peuples ; il les encadre, les limite, les disperse, puis les appelle à rendre compte.
1. Les nations dans le dessein de Dieu
Genèse 10 présente la « table des nations », non comme un accident du péché, mais comme une organisation réelle du monde post-diluvien. Ce passage précède immédiatement Babel (Genèse 11), montrant que la pluralité des peuples n’est pas d’abord un jugement, mais un cadre voulu pour l’histoire humaine.
Plus encore, dans l’alliance abrahamique, Dieu promet :
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre » (Genèse 12.3).
La bénédiction est universelle, mais elle passe par des médiations particulières. Dieu n’abolit pas les nations ; il les bénit à travers une alliance spécifique. Cette logique traverse toute l’Écriture : l’universalité n’est jamais immédiate, elle est toujours médiatisée, incarnée, limitée.
Le prophète Daniel va jusqu’à affirmer que la souveraineté des nations est directement ordonnée par Dieu :
« C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois » (Daniel 2.21).
Dans cette perspective, les nations ne sont ni absolues, ni illégitimes. Elles sont réelles, responsables et provisoires.
2. Babel : la tentation permanente de l’unité totale
L’épisode de Babel (Genèse 11.1 – 9) est central pour une théologie politique réformée. Il ne décrit pas un monde chaotique, mais un monde parfaitement organisé, uni par une langue, une technique et un projet commun :
« Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom » (Genèse 11.4).
Le péché de Babel n’est pas la diversité, mais l’unification totalisante. Ce que Dieu juge, ce n’est pas la coopération humaine en tant que telle, mais la prétention à une souveraineté collective sans limite, à une maîtrise de l’histoire qui se substitue à Dieu.
La dispersion opérée par Dieu n’est donc pas une malédiction pure, mais une limitation salutaire. Elle empêche la concentration totale du pouvoir et rappelle que l’histoire humaine ne peut être gouvernée par une instance unique sans sombrer dans l’idolâtrie.
C’est pourquoi Babel demeure une mise en garde permanente contre toute forme de gouvernement mondial absolu, même lorsqu’il se présente sous des atours moraux, juridiques ou humanitaires.
3. Alliance, loi et limites de l’ordre humain
Dans la théologie réformée, la loi a une fonction précise : contenir le mal, ordonner la vie commune, rappeler la justice. Mais elle ne sauve pas. Cette distinction vaut aussi pour le droit international.
Comme le souligne Jean Calvin, commentant Romains 13 :
« Les magistrats sont établis pour maintenir un certain ordre extérieur, non pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre. »
(Institution de la religion chrétienne, IV, 20)
Il n’existe donc pas, bibliquement, de souveraineté politique universelle humaine légitime. Toute autorité est relative, déléguée, limitée dans le temps et dans l’espace. Les nations sont responsables devant Dieu, mais aucune ne peut prétendre incarner la justice ultime.
Cela relativise profondément le rôle des instances internationales. Elles peuvent être :
– des lieux de coordination,
– des espaces de médiation,
– des cadres de rappel normatif.
Mais elles ne peuvent pas être le cœur souverain de l’histoire humaine, sans retomber dans une logique babelienne.
4. Le droit international : réel mais second
Dans cette perspective, le droit international possède une valeur réelle, mais seconde. Il est un instrument de limitation, non une autorité ultime. Il peut rappeler des principes, freiner certains excès, créer des cadres de dialogue. Mais il ne peut ni abolir le tragique de l’histoire, ni se substituer à la responsabilité morale des nations.
La responsabilité première demeure celle des États eux-mêmes, devant leur peuple et devant Dieu. Et au-dessus d’eux, la souveraineté ultime n’est jamais humaine.
L’Écriture rappelle sans cesse cette hiérarchie :
« Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et il le donne à qui il lui plaît » (Daniel 4.17).
Même les empires les plus puissants ne sont que des instruments provisoires dans une histoire qui les dépasse.
5. Conclusion théologique
La théologie de l’alliance permet ainsi de tenir ensemble trois affirmations essentielles, sans les opposer :
– les nations sont légitimes et nécessaires,
– leurs pouvoirs doivent être limités et jugés,
– aucune instance humaine ne peut prétendre gouverner le monde à la place de Dieu.
Elle protège à la fois contre l’idolâtrie de la nation absolue et contre l’idolâtrie d’un ordre mondial prétendument neutre et moralement pur. Elle rappelle que l’histoire est le lieu de la responsabilité, non de la rédemption politique.
C’est seulement dans cette humilité — reconnaissant les nations sans les sacraliser, le droit sans l’absolutiser, la force sans la glorifier — que peut se déployer une pensée chrétienne fidèle, lucide et libre face aux bouleversements du monde.
Position de synthèse
Il est possible — et même nécessaire — de tenir ensemble plusieurs affirmations que beaucoup opposent artificiellement, comme si la pensée devait choisir entre la pureté morale et la lucidité historique. Cette synthèse n’est pas un compromis mou ; elle est une discipline intellectuelle et morale exigeante, née de la confrontation avec le réel.
On peut affirmer sans incohérence que le régime Maduro constituait une injustice grave. Un pouvoir qui détruit l’économie de son pays, provoque l’exil massif de sa population, tolère ou organise des formes de criminalité transnationale et réduit toute opposition politique au silence ne peut être considéré comme moralement neutre. À ce titre, sa disparition n’est pas un mal en soi.
On peut affirmer tout aussi clairement que l’intervention américaine viole le droit international classique. Hors légitime défense immédiate ou mandat explicite, l’usage unilatéral de la force demeure juridiquement fautif. Le reconnaître n’est ni naïf ni anti-américain : c’est simplement nommer les choses avec rigueur.
Mais il faut immédiatement ajouter que cette violation peut produire un bien réel sans devenir un modèle. C’est ici que la sagesse tragique entre en jeu. L’histoire montre que des actions juridiquement fautives ont parfois contribué à mettre fin à des situations moralement pires, sans pour autant fournir une norme généralisable. Comme le rappelait Raymond Aron :
« Il n’y a pas de politique sans risque ni faute possible ; la sagesse consiste à choisir les risques que l’on accepte. »
(Paix et guerre entre les nations)
Reconnaître un effet bénéfique ne revient donc pas à légitimer la méthode, ni à l’ériger en précédent. C’est refuser le raisonnement binaire qui confond jugement moral et validation normative.
De là découle une autre affirmation centrale : la force est parfois nécessaire, mais toujours dangereuse. Elle peut contenir un mal plus grand, mais elle porte en elle une dynamique propre, corrosive, qui tend à s’autojustifier. C’est pourquoi Hannah Arendt insistait sur cette distinction décisive :
« Le pouvoir et la violence ne sont pas la même chose. Là où l’un règne absolument, l’autre est absent. »
(On Violence)
La force n’est jamais un fondement durable de la justice ; elle peut, au mieux, en être un instrument provisoire.
Dans le même mouvement, il faut affirmer que le droit reste indispensable, mais jamais suffisant. Indispensable, parce qu’il fournit un langage commun, des limites, une mémoire normative. Insuffisant, parce qu’il ne peut ni contraindre les puissances majeures, ni transformer des régimes criminels à lui seul. Comme le disait déjà Thomas Hobbes :
« Les pactes sans l’épée ne sont que des paroles. »
(Le Léviathan)
Cela ne conduit pas à mépriser le droit, mais à le resituer : comme un frein, non comme un sauveur.
De cette lucidité découle une autre conviction essentielle : aucune puissance n’est moralement pure. Les États agissent toujours à partir d’intérêts mêlés, d’intentions partiellement justes et partiellement corrompues. Espérer une politique internationale immaculée revient à attendre de l’histoire ce qu’elle ne peut offrir. Comme l’écrivait Max Weber :
« Celui qui cherche le salut de son âme et celui qui cherche le salut des autres par la politique n’ont pas la même tâche. »
(Le Savant et le Politique)
Enfin, cette synthèse impose de refuser toute absolutisation : aucune institution humaine ne doit être érigée en instance ultime de l’histoire. Ni l’État-nation, ni l’empire, ni l’ordre international, ni une organisation multilatérale ne peuvent prétendre incarner la justice définitive. La théologie biblique est sans ambiguïté :
« Le Très-Haut domine sur le règne des hommes » (Daniel 4.17).
Cette position est donc fermement réaliste, parce qu’elle regarde le monde tel qu’il est, et non tel que nous voudrions qu’il soit. Mais elle est aussi moralement contrainte, parce qu’elle refuse de transformer la nécessité en vertu, la force en droit, le succès en justification.
Elle rejette les indignations sélectives, qui condamnent la violence seulement lorsqu’elle vient de certains acteurs, et les enthousiasmes aveugles, qui célèbrent la puissance dès lors qu’elle frappe un ennemi détesté.
C’est une position tragique au sens noble : lucide sur la permanence du mal dans l’histoire, sans renoncer pour autant au bien possible ; consciente que toute action est imparfaite, sans sombrer dans le relativisme ; convaincue que l’homme n’est jamais sauveur de l’histoire, sans pour autant se réfugier dans l’inaction.
Pour reprendre une intuition augustinienne fondamentale, l’histoire des nations est un champ de responsabilités imparfaites, où l’on n’échappe jamais totalement à la faute, mais où l’on est toujours responsable de ce que l’on fait — et de ce que l’on laisse faire. C’est dans cette tension, inconfortable mais féconde, que peut se tenir une pensée politique chrétienne digne de ce nom.
- Assistance IA (ChatGPT) utilisée pour la rédaction. ↩︎
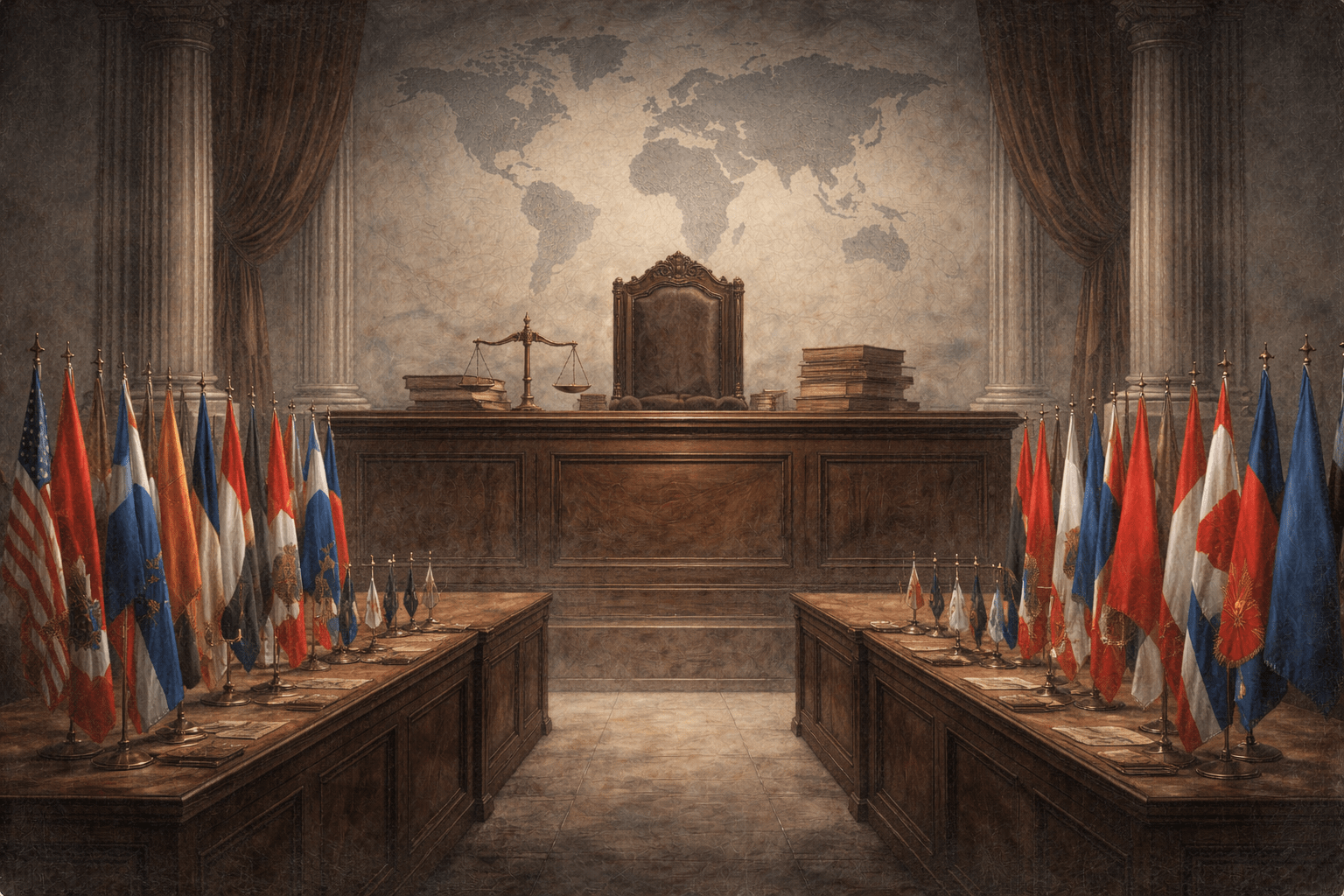
Laisser un commentaire